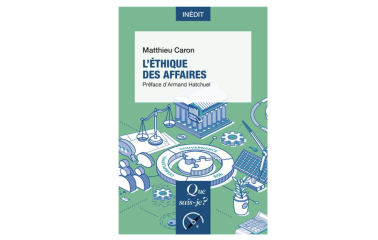Qui sont les lobbies en faveur du climat et plus largement du bien commun ? Après le succès historique de la pétition contre la loi Duplomb qui a enregistré plus de 2,1 millions signataires au cœur de l’été, les Français ont largement démontré qu’ils étaient (toujours) de fervents défenseurs de l’environnement. Mais face au désamour des figures politiques, à la méfiance vis à vis des entreprises, au scepticisme quant aux activistes, quel est le véritable pouvoir des nouveaux lobbies d’intérêt général ?
A six mois des prochaines élections municipales et à dix-huit des présidentielles, les grands sujets liés à la transition, au climat, à la RSE, à l’alimentation et aux énergies déchaînent à nouveau les passions. Après les débats sur les polluants éternels, ceux sur la question du bien-être animal via la captivité des orques du Marineland à Antibes, les derniers scandales alimentaires (et notamment celui autour des bouteilles d’eaux minérales) et évidemment nul ne peut ignorer la levée de bouclier contre la loi Duplomb…
Un cadre de plus en plus net semble désormais posé : militants, ONG et groupes d’influence ne laisseront rien passer et comptent bien peser dans les discussions à venir ces prochains mois. Pourtant l’environnement n’arrive qu’en 5e position (22%) des préoccupations qui influenceront le plus les choix de vote, loin derrière la sécurité (51%), l’activité économique et le commerce (31%), la propreté (26%) ou l’éducation (24%), selon le dernier baromètre Odoxa réalisé avec Mascaret pour Public Sénat et la presse régionale.
Or si les figures politiques écologistes ne possèdent qu’une faible notoriété (18% de confiance pour Marine Tondelier et 16% pour Clémentine Autain selon Toluna Harris Interactive/LCI juin 2025, 13% pour Sandrine Rousseau selon Elab, juin 2025), de très nombreuses associations jouent en France et depuis des années les anges gardiens de nos assiettes, de notre santé, de notre environnement. FoodWatch, Greenpeace, Bloom, WWF, France Nature Environnement – pour ne mentionner qu’une infime partie des plus connues…
Que dit la loi ?
Les lobbies sont encadrés par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HAVP) depuis le 1er juillet 2017 et la loi Sapin II n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. La HAVP définit le « lobbying » ou la « représentation d’intérêts » comme une activité qui consiste à prendre l’initiative d’entrer en contact avec des personnes chargées d’élaborer et de voter les décisions publiques ou de conduire l’action publique nationale ou locale pour influencer leurs décisions.
Les acteurs socio-économiques (entreprises, associations, ONG, cabinets de conseil, etc) qui cherchent à influer sur le contenu d’une décision publique en entrant en communication avec un responsable public doivent donc obligatoirement s’inscrire au répertoire des représentants d’intérêts, déclarer leurs actions de lobbying et les moyens qui y sont consacrés. Des règles déontologiques permettent d’encadrer les relations entre les représentants d’intérêts et les responsables publics, afin de développer un lobbying responsable.
En 2024, selon la Haute autorité de la vie publique, 3 215 entités étaient enregistrées au répertoire des représentants d’intérêts (contre 2871 au 1er juillet 2023) dont 35,5% de groupements professionnels, 30% d’entreprises, 22% d’ONG, 9% de cabinets de conseil, d’avocats, consultants indépendants, et 3,5% d’autres types d’organisations ou d’organismes de réflexion et de recherche. Et 159 633 fiches d’activités de représentation d’intérêts avaient été déclarées.
Communication et influence au menu
Juridiquement donc, le lobbying se définit comme l’ensemble des actions de communication et d’influence menées par des groupes socioéconomiques pour interpeller et s’adresser aux pouvoirs publics décisionnels via un mode d’action individuel ou collectif dans la défense d’intérêts généraux ou privés. A l’origine le lobbying émanait surtout de grands groupes économiques privés mais émergent de plus en plus des groupes qui tente de défendre l’intérêt général et le « bien commun » autour des thématiques sociales, sociétales, environnementales, etc.
La principale différence étant le poids économique et les financements de ces différents lobbies. Les lobbies industriels pesant ayant par exemple des moyens financiers bien plus importants pour mener des groupes de travail, d’influence, des événements, des opérations marketing que les lobbies d’intérêt général… Ces derniers doivent donc mener des campagnes d’influence bien plus astucieuses, lever des fonds auprès de l’opinion publique, communiquer -à moindre coût- via les réseaux sociaux et les relations presse pour tenter de peser dans les débats publics et convaincre, faire passer leurs idées, contrebalancer les informations (souvent plus massivement) distillées par les lobbyistes « traditionnels ». Attention toutefois, ces dernières années certains tentent de jouer au Cheval de Troie et de se faire passer pour ce qu’ils ne sont pas…
Influencer le débat public
Ainsi le « Fonds du bien commun » (et ses événements les nuits du bien commun) est un organisme fondé en 2021 par l’homme d’affaires ultra-conservateur d’extrême droite Pierre Edouard Stérin (le fondateur des coffrets cadeaux Smartbox). Leur objectif : influencer le débat public et financer des associations très conservatrices défendant des « causes » clairement anti-IVG, pro « remigration », la défense de la vie (anti droit à l’euthanasie) ou encore de l’amour éternel (pas de divorce, pas de mariage pour tous)…
Heureusement, ces dernières années de nombreux groupes, lobbies, think-tanks, collectifs défendant (vraiment) l’intérêt général et le bien commun se sont constitués en France et lancent des contre-offensives face aux lobbies économiques, des énergies fossiles ou ultra-conservateurs. Avec pour l’instant plus ou moins de succès et de poids sur les décideurs, les politiques ou l’opinion publique…
« C’est très sain qu’il y ait le plus de lobbies possible en France, fondés par un maximum d’acteurs de tous horizons« , souligne Inès Rodriguez-Albacar, directrice générale adjointe de The Good Lobby France. Fondé en 2015, cette start-up a pour mission de créer du lien entre les décideurs et ceux qui n’ont jusqu’ici pas eu la chance d’accéder aux débats, de revivifier les institutions démocratiques, notamment via le programme « Lobbying pour tous », l’initiative « Les Oubliés de la République », la publication d’études, du guide du lobbying citoyen, etc…
« Notre métier de lobbyiste est encore très mal connu »
« Nous sommes une sorte de think and do tank, ajoute la directrice générale adjointe. Notre métier de lobbyiste est encore très mal connu et perçu. En France, les gens pensent souvent que les lobbies sont les « grands méchants » mus uniquement par les industriels du pétrole, de la chimie, du plastique. Alors que d’autres secteurs déjà très avancés dans la transition et l’adaptation font aussi du lobbying et que parmi eux on dénombre une myriade de tout petits acteurs, des startups, des PME, des associations, mais aussi des experts, des techniciens. Or, il est primordial qu’un maximum d’acteurs de la société économique comme civile puissent donner leur point de vue, alerter, agir et peser dans le débat public et la fabrique de la loi et qu’ils puissent ainsi éclairer les décideurs« . Car les lobbies « fossiles », eux, sont en ordre de bataille depuis bien plus longtemps et ont à maintes reprises dans notre histoire politique prouvé leur pouvoir d’influence dans la fabrique des lois. Mais qui est aujourd’hui de taille pour leur faire face dans le camp écologiste, social, sociétal et plus globalement de la défense de l’intérêt général et du bien commun.
« Pour autant, je pense qu’il n’existe pas encore de véritable et puissant lobby environnemental en France, au sens de la définition de la haute autorité de la vie publique » (lire encadré), observe Amélie Deloche, co-fondatrice du collectif Paye ton influence. Les ONG et les associations font de l’activisme, rédigent et exposent de plus en plus de plaidoyers et tentent ainsi d’émerger dans les médias, auprès des politiques ou imaginent des collaborations avec quelques influenceurs, mais c’est encore très difficile pour les acteurs de la transition de peser dans les médias ou dans le débat public avec le même poids et le même impact que les lobbies « fossiles », industriels, chimiques, ou de la fast fashion qui sont très nombreux et qui ont des moyens incomparables ». Il existe bien des collectifs, des think tanks, des groupes de lobbying tels qu’Ecolobby[1], l’DDRI (L’Institut du développement durable et des relations internationales), le Think Tank de la Fondation pour la nature et l’homme, l’Institut Rousseau, la Fabrique écologique, Terra Nova, ou Ecologie Responsable (le nouveau (et premier?) think tank écolo de droite!), mais aucun n’est encore aussi connu, structuré ou médiatisé que ceux du camp adverse.
Le lobbyiste vert le plus célèbre, grâce à sa présence et ses prises de paroles sur les réseaux sociaux étant sans doute Jean-Marc Jancovici avec son ONG The Shift Project. « Aucun n’a encore cette notoriété ni cette visibilité car l’écologie, contrairement à l’économie ou la politique n’est pas vue comme une matière d’actualité chaude par les médias et les journalistes », analyse Eva Morel, fondatrice de l’association Quota Climat. Et c’est bien là que le bas blesse… A part lors d’épiphénomènes climatiques catastrophiques comme les inondations, les incendies ou les canicules, les questions d’environnement ne font jamais la Une de l’actualité avec de grands sujets de fond. Le combat de Quota Climat est donc de demander aux autorités compétentes d’imposer dans les médias plus de temps accordé à ces sujets, aux experts, aux spécialistes et scientifiques.
Lutter contre la désinformation climatique
« Et, victoire, en 2022, c’est la première fois qu’une question sur l’écologie est apparue dans le débat d’entre deux tours à la présidentielle en France et a été posée par les journalistes, ajoute Eva Morel qui souhaite désormais aller encore plus loin. En 2025 la désinformation climatique a été reconnue lors de la COP 30 et des engagements juridiques et parlementaires ont été pris par plusieurs états comme cela existe déjà sur la représentativité des femmes ou des minorités ou la protection de l’enfance ». Selon Quota Climat les instances comme l’Arcom devraient réguler et imposer des volumes horaires ou des temps de parole consacrés à l’information scientifique, à l’environnement et au climat. « Nous faisons des propositions législatives en ce sens, nous avons lancé des outils de fact-checking pour lutter contre la désinformation, nous produisons des données objectivées via notre baromètre data For Good ou l’observatoire des médias sur l’écologie. Le tout pour améliorer les pratiques des médias au quotidien, sensibiliser les journalistes et finalement faire émerger ces sujets et questions dans le débat public ».
Mais le lobbying vert ou d’intérêt général, au sens de la définition de la Haute autorité de la vie publique et de la loi émerge tout de même de plus en plus. « Quand nous avons lancé notre cabinet il y a 5 ans c’était pour démontrer qu’il n’y avait pas que les très grands lobbies fossiles qui pouvaient s’inscrire dans le débat et intervenir dans la fabrique de la loi, explique Valérie Gramond, co-fondatrice et directrice générale de GreenLobby. Il y a toujours quelqu’un qui dit « non » quand il s’agit de défendre une loi, notamment environnementale ou sociale au Parlement, au gouvernement ou au Parlement Européen. Et c’est souvent une grande entreprise, de plus en plus souvent américaine qui le fait et instaure un rapport de force entre écologie et économie. Or nous voulons démontrer que l’écologie ne s’oppose pas toujours à l’économie. Pour faire contre poids face à ces énormes entreprises ou au MEDEF, à l’AFEP ou la CPME nous devons aussi nous organiser en rassemblant les voix des ONG, des radicaux, des activistes, des startups, des entreprises de l’ESS, etc. Notre idée : monter un « contre-lobby » car ces acteurs ont peu de moyens humains et financiers pour se faire entendre face aux grands lobbies traditionnels« .
L’astuce serait désormais de se structurer pour tenter de peser aussi fort et bien que les lobbies fossiles. « Nous sommes un cabinet de lobbying avec une connaissance fine de la fabrique de la loi et nous nous positionnons comme des experts techniques (influence, juridique, scientifique, etc) pour tous les acteurs de la transition écologique. Nous les aidons à se mobiliser, s’organiser et se coordonner et nous les accompagnons pas à pas pour peser dans les décisions et cette fabrique de la loi. Exactement comme le fait un cabinet de conseil en affaires publiques« , résume Hugo Cartalas, co-fondateur et directeur du plaidoyer de GreenLobby.
Ringardiser les lobbies industriels
Leurs armes : utiliser les instruments du pouvoir pour « ringardiser » les lobbies industriels et influencer les décideurs en déposant des amendements, se faire connaître dans les ministères et les services de l’administration, publier des études, lancer des pétitions, professionnaliser ses plaidoyers, créer des événements politicomédiatiques, faire du « shame and name » (dénoncer ouvertement certaines entreprises ou pratiques notamment d’écocides ou de grands pollueurs), apporter du contradictoire dans les débats…
« Les acteurs de la transition doivent se fédérer et avoir une vision du monde commune pour mieux la faire émerger dans les débats, ajoutent les deux fondateurs de GreenLobby. Ils doivent être en coopétition pour faire entendre leur voix, c’est ça qui fait gagner des combats dans le monde du lobbying ! L’opinion publique est l’alliée de nos combats. Nous devons lui faire prendre conscience que la transition favorise l’investissement, l’innovation, il faut imaginer la loi non comme une nouvelle contrainte mais comme un cadre du champ des possibles qui protège l’activité économique, elle-même totalement dépendante du vivant et de l’environnement. Il suffit de 3% de gens pour faire basculer la société!« .
Le monde a besoin de l’innovation sociétale et de l’allocation optimale des ressources pour parvenir à nous adapter et à faire cette transition vitale pour tous… Et la grande différence entre les lobbies fossiles et les nouveaux lobbies « verts », outre leur taille et leurs moyens, c’est évidemment leurs valeurs et leurs raisons d’être. « Nous portons des sujets d’intérêt général et de bien commun et nous ne faisons pas de l’influence pour servir des intérêts privés, économiques ou politiques« , conclut Eva Morel.