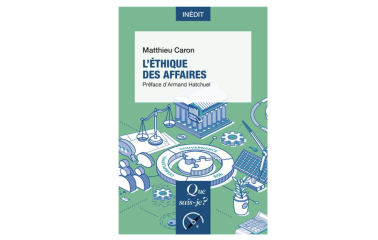Il n’y a pas que la sève d’hévéa pour obtenir du latex naturel. Il y a également… le pissenlit et le guayule ! Et c’est ce dernier, petit arbuste originaire du Mexique, qui va nous occuper aujourd’hui. Parce qu’une entreprise française du nom de GuaTecs a récemment été créée pour développer le latex de guayule et que son projet, méritoire à plus d’un titre, mérite d’être connu et soutenu.
Le guayule, donc, est un petit arbuste dont l’écorce contient environ 10 % de particules de latex. Et ce latex a, entre autres avantages, celui d’être hypoallergénique. « Jusqu’à aujourd’hui, le seul le latex naturel qui existe est celui de l’hévéa et il est allergisant, le guayule ne l’est pas », souligne Michel Dorget, co-fondateur de l’entreprise GuaTecs. Ce latex est donc susceptible d’intéresser tous les acteurs qui utilisent actuellement du latex synthétique haut de gamme, notamment le secteur médical, gros consommateur de gants. « Notre latex est biosourcé, sans solvant et non allergisant. Il permet en outre de faire des gants plus souples et plus résistants. Et les acteurs qui veulent aujourd’hui ces cinq avantages, doivent acheter un latex synthétique qui vaut dix fois plus cher que le latex d’hévéa. »
GuaTecs vise les applications médicales mais aussi le textile, « le latex est utilisé pour les enductions (enduits) dans le domaine du luxe, pour imperméabiliser certains tissus comme pour les nappes ou les cirés. L’enduction classique est faite avec du PVC. » Du plastique, donc. C’est également le cas en cosmétique où le latex est utilisé comme liant. Aujourd’hui, ces liants sont des polymères synthétiques.
Le guayule est également vertueux en termes environnemental. Peu exigeant en eau, il devrait gagner le cœur des agriculteurs du sud de l’Europe. « Nous sommes partenaires d’un projet européen qui vise à valoriser les friches agricoles, les terres qui ont été abandonnées car il fait trop chaud, les terres dégradées, explique Michel Dorget. De plus en plus de terres sont abandonnées, faute d’eau. Au sud de la France et de l’Europe, notamment en Espagne, il y a beaucoup de friches sur lesquelles le guayule pourrait être planté. L’objectif de ce projet européen est d’identifier les plantes que l’on va pouvoir planter sur ces friches et les filières agro-industrielles à développer. Nous bénéficions de fonds européens pour aider au développement de notre projet et aider les agriculteurs qui planteront du guayule. Nous bénéficions également de financement au niveau national et régional. Mais nous avons besoin de lever des fonds. »
Un sujet de souveraineté
Le sujet du latex est aussi un sujet de diversification des sources d’approvisionnement et de souveraineté. « Aujourd’hui, l’hévéa est ciblé par la règlementation européenne sur l’anti-déforestation, explique Michel Dorget. Depuis un an et demi, pour avoir le droit d’importer du latex d’hévéa, il faut prouver que sa culture n’a pas contribué à la déforestation. Il est donc important de développer des sources locales d’approvisionnement. »
Le guayule, met également en avant Michel Dorget, permettra de renforcer notre souveraineté car, pour l’heure, tous les gants médicaux sont importés d’Asie. Mais il est vrai, nuance-t-il, qu’il faudra créer toute la chaîne de production en local. » Le matériau organique du latex/caoutchouc, commente-t-il, a été inscrit sur la liste des matériaux critiques à l’échelle européenne en 2017 car « il existe beaucoup de choses qu’il est impossible de produire sans caoutchouc naturel, comme les pneumatiques pour les camions ou les avions, par exemple. » Pour autant, travailler sur un des éléments inscrits sur cette liste ne permet pas d’obtenir d’aides directes à la production. « C’est simplement une sorte de label qui fait que l’Europe fera peut-être plus d’appels à projets sur des thématiques en lien avec ce qu’il y a dans cette liste. » L’Europe est par contre aidante sur le financement de développement et d’installations.
Mais comment diable Michel Dorget et ses associés ont-ils eu vent de l’existence de ce petit arbuste et comment en sont-ils venus à vouloir produire du latex naturel de guayule à échelle industrielle ? L’intéressé explique qu’il travaille depuis plus de 30 ans dans les latex. « Je dis les latex, car il n’y en a pas qu’un. Il y a des latex naturels et des latex synthétiques. Et dans chacune de ces catégories, il existe nombre de sous-familles. Le latex, on les retrouve dans de nombreux et différents domaines : dans des papiers, des peintures, des adhésifs. C’est un produit très répandu. J’ai démarré dans les latex synthétiques pour le domaine de la chimie, puis j’ai travaillé sur le latex naturel. Le plus connu est l’hévéa. Au deuxième rang, il y a le guayule et au troisième rang, le pissenlit, qui est également très étudié. Ces trois plantes permettent de trouver du latex partout sur la planète, chaque plante étant adaptée à des environnements climatiques différents. L’hévéa pousse en zone tropicale, le guayule dans des zones semi-arides et pissenlit dans les zones continentales. »
Projet européen destiné à identifier des alternatives à l’hévéa
Le projet GuaTecs a démarré il y a une quinzaine d’années, à la naissance d’un projet européen destiné à identifier des alternatives à l’hévéa, impossible à cultiver en Europe. Restait, pour les entrepreneurs, à choisir entre le pissenlit et le guayule. Choix vite opéré : « Le pissenlit est plus adapté pour faire du caoutchouc pour différentes raisons techniques et liées à la structure de la plante ; il permet de faire du caoutchouc utilisé dans les pneumatiques, par exemple. Le guayule est plus adapté pour faire du latex. Les deux plantes, qui sont complémentaires, ne s’adressent pas aux mêmes zones pédoclimatiques. Le guayule est pour le sud de l’Europe, France, Italie, Espagne, et le pissenlit pour le nord, Allemagne, Hollande. »
A l’époque, deux organismes de recherche publique travaillaient sur ce projet. Le CIRAD (centre international de recherche agronomique) et le CTTM (centre de transfert de technologies du Mans). Michel Dorget travaillait alors pour le CTTM. « Ces deux organismes ont déposé le brevet sur le procédé d’extraction du latex sur le guayule », raconte-t-il. Car l’extraction est une opération complexe. « Si, pour l’hévéa, il suffit de saigner l’arbre tous les jours, il n’en va pas de même pour le guayule, qui est un petit buisson et le latex est emprisonné dans les cellules de l’écorce. Une fois le procédé d’extraction breveté, nous nous sommes interrogés sur son exploitation ». Michel Dorget a alors fait la tournée des acteurs mondiaux du guayule pour voir si le procédé pouvait les intéresser…. Mais personne ne l’était. Alors, plutôt que de renoncer à un projet en lequel ils avaient foi, Michel Dorget et ses co-inventeurs se sont associés pour créer eux-mêmes cette entreprise et mettre le guayule sur le marché.
En 2019, GuaTecs est né. « Nous avons négocié une licence sur le brevet, parce que nous en étions les inventeurs mais pas les propriétaires, et commencé à travailler sur cette technologie. Elle avait été brevetée à une échelle laboratoire et nous l’avons amenée à une échelle pilote. Nous avons monté une petite unité d’extraction qui nous permet de sortir quelques litres de latex par jours et qui nous ont permis d’échantillonner des clients. Nous avons eu la validation technique à l’échelle laboratoire chez nos clients. »
Pour développer son projet, GuaTecs a aujourd’hui besoin de lever de l’argent. Aujourd’hui, il vit grâce aux fonds propres des créateurs et des capitaux publics accordés par BPI et l’Ademe. « Nous avons été lauréats de I-Lab et la dotation nous a permis de financer plusieurs années de fonctionnement de l’entreprise », relate Michel Dorget. Mais il s’agit maintenant de produire en grande quantité : « nous devons construire une grosse usine et, donc, trouver des investisseurs pour avoir des fonds. Nous cherchons 3 millions d’euros ».
Par prudence, le projet a été conçu à l’échelle européenne. Lorsque le modèle aura pris, il sera alors temps de gagner l’international. Et même à cette échelle, il va prendre du temps puisque cette danse est à deux pas de trois ans. D’ici à trois ans, GuaTecs espère édifier une petite usine, et il lui faudra trois ans de plus pour procéder à l’industrialisation. « Tout est long », soupire Michel Dorget, même la croissance du guayule, qui « ne donne du latex que deux ans, minimum, après plantation ».
La quête d’agriculteurs
Guatecs compte aujourd’hui sur 6 hectares de plantations, située autour de Montpellier, gérées sous la forme de contrats de culture (fermage). Pour parvenir à l’échelle industrielle, il va lui falloir des milliers d’hectares. Pour les trouver, les dirigeants travaillent, depuis deux ans, avec les plus grandes coopératives du sud de la France. « Elles sont très intéressées car en recherche de cultures alternatives aux cultures actuelles, gourmandes en eau », explique Michel Dorget. « Les coopératives vont être notre relais pour mobiliser des centaines d’agriculteurs et ainsi trouver les milliers d’hectares qui nous serons nécessaires. »
Guatecs est au milieu du gué. Avec des clients potentiels « qui ont validé la qualité du latex à échelle pilote » mais qui ne s’engageront pas sur des commandes fermes tant que l’entreprise ne pourra pas produire des tonnes de latex « afin qu’ils puissent faire leurs essais ». Mais, si l’entreprise connaît les quantités qu’ils consomment annuellement et les grandeurs de prix qui pourront les satisfaire – « Nous avons quantifié les besoins et dimensionné le projet d’usine en fonction » -, il lui faut valider à plus grande échelle. « C’est toute la difficulté, il me faut synchroniser l’amont et l’aval. Discuter avec les agriculteurs et discuter avec les clients car il faut que tout soit synchronisé. »
Difficile d’entreprendre sur des contrées encore peu défrichées… alors même que le latex de guayule est reconnu comme une filière agro-industrielle très positive. Elle a même été labellisée par la Fondation suisse Solar Impulse « qui labellise les solutions positives pour l’environnement, les hommes et le business ». Ce petit arbuste a tout bon. Espérons qu’il grandira vite sur nos territoires.