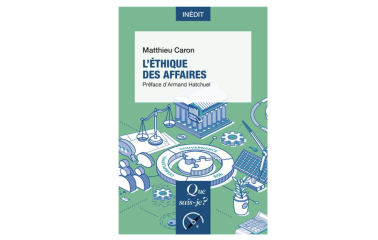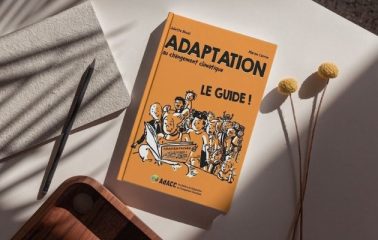La baisse de 42 % des fonds alloués à l’aide humanitaire internationale depuis le début 2025 n’est pas un simple ajustement conjoncturel : c’est un basculement. La suppression des fonds de l’USAID décidée par l’administration Trump a des conséquences immédiates. Prenons deux exemples : environ 20 % des opérations de Handicap International ont été affectées, et 36 % des projets menés par Solidarités International sont aujourd’hui mis en péril. Nous parlons de millions de bénéficiaires. Ce désengagement américain s’inscrit dans une tendance plus large. En France, la diminution des subventions publiques, couplée à l’essoufflement des dons, laisse des centaines d’associations dans l’incertitude. Les financements sont moins nombreux, plus courts, plus conditionnés. Ce sont des choix budgétaires dont les effets sont très concrets : activités suspendues, missions amputées, structures contraintes de fermer.
Cette situation révèle une tension ancienne et structurelle : les associations assument des missions d’intérêt général essentielles, mais sans bénéficier de la visibilité ni de la stabilité que cela supposerait. Or, on oublie souvent que l’action associative produit aussi une valeur économique : prévention, lien social, accompagnement, insertion – tout cela évite des coûts bien supérieurs à la collectivité. Autrement dit, la solidarité n’est pas un luxe. Elle est un socle.
Et maintenant, qui porte la parole ?
Ce moment critique oblige à une remise en question plus large : que dit-il de notre système de financement de l’intérêt général ? Que dit-il de notre capacité à articuler les moyens avec les missions ? Mais aussi : qui, aujourd’hui, peut contribuer à porter ce débat dans l’espace public ?
C’est là que notre secteur – celui de la communication, de la publicité, des médias – entre en jeu.
Ce n’est pas une question de posture, encore moins de générosité. C’est une question de rôle et de responsabilité. Parce que nous disposons d’une compétence rare : celle de faire entendre des récits, de traduire des enjeux complexes, de produire de l’attention dans un univers saturé, de faire résonner les bons messages auprès des bons publics. Et cette compétence peut, dans un moment de bascule comme celui que nous traversons, devenir un levier d’intérêt général.
Le secteur publicitaire, levier de soutien indirect
Il ne s’agit pas de se substituer aux financeurs institutionnels, ni de transformer la publicité en guichet alternatif. Il s’agit d’activer un levier complémentaire, qui n’a pas encore été mobilisé à sa juste mesure. En réallouant, par exemple, une partie de leurs budgets média vers des formats solidaires, les marques peuvent financer des projets associatifs tout en renforçant la cohérence de leur communication. C’est le modèle que porte Goodeed depuis sa création, et qui a déjà permis de reverser près de 10 millions d’euros à des associations et des ONG.
Ce modèle n’est pas la solution à tous les problèmes de financement du secteur associatif. Mais il constitue un déclencheur possible. Il offre un cadre dans lequel un secteur économique – le nôtre – peut contribuer de manière spécifique, à partir de ses savoir-faire propres, à un enjeu collectif. Il ne s’agit pas de faire du mécénat par la bande, mais d’inscrire l’impact dans les flux existants, en rendant plus intelligents, plus justes et plus utiles les investissements publicitaires.
Ce modèle révèle un potentiel plus large : celui d’une contribution spécifique du secteur de la communication, dans toutes ses composantes, à la transformation sociale.
Une dynamique collective qui appelle une structuration
C’est dans cet esprit qu’a été organisé, le 27 juin dernier, le premier workshop solidaire à l’initiative de Goodeed. Plus de 80 professionnels issus d’agences, de régies, de grandes marques, d’ONG, d’associations, de fondations se sont réunis pour construire ensemble des pistes d’action. Certaines très concrètes : mise à disposition d’espaces publicitaires, outils de mise en relation, campagnes collectives… D’autres en devenir. Mais toutes sont le signe d’un mouvement.
Et ce mouvement a besoin d’un socle.
C’est le rôle du manifeste publié à l’issue de cette rencontre. Il ne s’agit pas d’une pétition de principe, ni d’un texte d’intention. C’est un acte fondateur, qui pose les bases d’une coalition ouverte à toutes celles et ceux qui veulent inscrire la solidarité dans les usages de notre secteur. Le manifeste définit un cadre d’action, des principes, une ambition collective. Il s’accompagnera d’outils : tableau de bord collaboratif, suivi des engagements, mutualisation des initiatives… Parce que ce que nous avons enclenché n’a de valeur que s’il se prolonge, se structure et se transmet.
Une invitation, pas une injonction
Personne ne prétend que le secteur de la communication va résoudre la crise humanitaire. Mais il peut y répondre à sa manière, avec ses propres outils.
Il peut refuser l’impuissance. Et surtout, il peut éviter un piège bien connu : celui de l’indignation sans suite. L’élan collectif est là. L’impulsion est donnée. Il s’agit désormais de la faire vivre dans la durée.
C’est une invitation à agir, chacun à son niveau. Parce que dans un secteur qui touche des millions de personnes chaque jour, chaque message compte. Faisons que ce message soit solidaire.
Vincent Touboul Flachaire, CEO de Goodeed