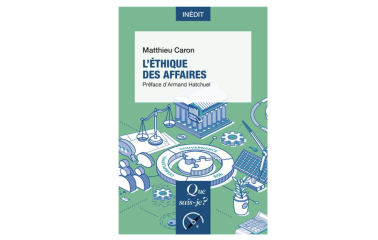Alors que les limites planétaires sont de plus en plus dépassées, l’Impact Tank publie un rapport stratégique majeur pour guider les entreprises vers une économie à visée régénérative.
Fruit d’un an de recherche et de collaboration avec des acteurs publics, privés et associatifs, ce document propose un référentiel inédit, aligné avec les normes internationales (CSRD, ESRS) mais enrichi de dimensions clés comme la relation au vivant, la gouvernance partagée ou encore l’impact net positif.
Le rapport s’appuie sur l’analyse de 50 projets pionniers, de Label Emmaüs à Amarenco, et formule 15 recommandations concrètes, dont la création d’une plateforme nationale de mesure d’impact et l’intégration de l’économie régénérative dans les politiques publiques territoriales.
Une invitation claire à dépasser la conformité pour faire de la mesure d’impact un levier de transformation systémique.
👉 Consulter le rapport ici
Explications de Tony Bernard, directeur général de l’Impact Tank :
The Good : Pourquoi était-il urgent aujourd’hui de proposer un référentiel spécifique à l’économie régénérative, au-delà des normes actuelles comme la CSRD ou la double matérialité ?
Tony Bernard : La CSRD représente une avancée historique, même depuis l’initiative du paquet Omnibus du 26 février dernier. Elle marquera selon moi l’entrée dans l’économie d’impact en faisant disparaître la séparation entre le « business as usual » d’un côté et la RSE de l’autre, qui en serait le supplément d’âme. Par ailleurs, en facilitant la comparaison des données grâce aux ESRS, la directive permettra de réaliser des benchmark secteur par secteur, et promet d’ériger la durabilité au rang de facteur de compétitivité, au même niveau que le prix, la qualité, les fonctions, le délai de livraison ou la réputation.
Mais face à l’urgence écologique et sociale, le défi est aujourd’hui de transformer nos modèles d’entreprendre. Selon le rapport final de la Convention des entreprises pour le climat publié en 2022, six des neuf limites planétaires sont déjà dépassées. Ce constat alarmant montre que nous avons franchi des seuils critiques pour le maintien des conditions stables de la vie sur Terre. Dans un tel contexte, chercher à réduire son impact, même de manière radicale, ne suffit plus. Il ne s’agit plus uniquement de limiter les dommages, mais de changer de paradigme. Nous devons désormais entrer dans une logique de régénération, c’est-à-dire réparer, restaurer, et recréer les conditions du vivant. C’est d’ailleurs ce que la nature sait faire depuis toujours : elle est, par essence, résiliente et régénérative.
La mesure est un autre défi de taille. Certaines certifications, comme le label Regenerative Organic Certified (ROC) lancé en 2017 avec le soutien d’entreprises telles que Patagonia, ont tenté de mesurer les capacités régénératrices des pratiques des entreprises. Cette démarche a été essentielle pour crédibiliser l’engagement des acteurs économiques mais elle met également en lumière la complexité de cette évaluation : à ce jour, il n’existe pas de référentiel commun ou standardisé de mesure d’impact, ce qui limite la comparabilité et l’universalité des approches. Cette absence de cadre partagé rend le sujet plus vulnérable aux critiques et soulève des questions sur la rigueur, la cohérence et la transparence des démarches engagées. C’est pourquoi, nous avons notre groupe de travail !
The Good : Vous appelez à la création d’une plateforme nationale de mesure d’impact. Quels sont, selon vous, les leviers – mais aussi les freins – pour qu’une telle initiative voie concrètement le jour ?
Tony Bernard : Il existe aujourd’hui une grande diversité d’approches pour mesurer l’impact social et environnemental des activités économiques. On retrouve à la fois des outils volontaires — comme des labels, certifications, normes ou statuts — et un cadre réglementaire de plus en plus structuré, à l’échelle nationale et européenne. Ce foisonnement de référentiels est, en soi, un signe encourageant : il témoigne d’une prise de conscience croissante de l’importance de ces enjeux dans le monde économique.
Cependant, cette profusion engendre également une certaine confusion et une hétérogénéité des données produites. Cela freine la capacité des acteurs publics, privés et de la société civile à coopérer efficacement et à aligner leurs stratégies sur des objectifs communs.
Dans ce contexte, la création d’une plateforme nationale de mesure d’impact représenterait un levier structurant. Elle permettrait d’harmoniser les indicateurs utilisés, en s’appuyant sur un référentiel commun – tel que celui que nous avons proposé dans le cadre de notre rapport – et en intégrant des méthodologies reconnues (comme l’analyse de cycle de vie, les calculs d’empreinte carbone ou biodiversité, ou encore l’évaluation d’impact social), ainsi que des bases de données sectorielles.
L’objectif serait double : faciliter la comparaison, le suivi et l’amélioration des pratiques d’un acteur à l’autre, et assurer l’interopérabilité avec les systèmes de reporting existants, comme les outils ESG ou les référentiels de la CSRD.
Pour garantir la réussite d’un tel projet, il serait essentiel de réunir autour de la table les acteurs économiques, les chercheurs et les pouvoirs publics. Une gouvernance partagée, associant expertise scientifique et connaissance du terrain, serait la clé pour construire une plateforme crédible, utile et largement adoptée.
The Good : Les 50 projets analysés dans le rapport montrent que la régénération n’est pas réservée à quelques pionniers. Quelles conditions sont nécessaires pour généraliser ces approches dans les modèles économiques classiques ?
Tony Bernard : Les 50 initiatives étudiées montrent clairement que l’économie régénérative n’est plus une utopie réservée à quelques pionniers éclairés : elle est déjà en marche, portée par une diversité d’acteurs – entreprises, structures de l’économie sociale et solidaire, territoires – qui expérimentent des pratiques concrètes, ancrées dans la réalité économique, sociale et écologique.
Si ces projets ne sont pas encore pleinement régénératifs, ils intègrent néanmoins des « marqueurs du régénératif », que nous avons identifiés comme autant de leviers tangibles pour transformer les modèles économiques existants. Leur recensement nous a permis de mieux comprendre comment les organisations agissent, quels cadres normatifs elles adoptent, et comment elles articulent impact positif et viabilité économique. La majorité de ces initiatives sont portées par des structures commerciales, souvent de petite taille ou à l’échelle locale, animées par une volonté sincère de concilier rentabilité et contribution au bien commun.
Ce mouvement témoigne d’un changement de paradigme en cours : de plus en plus d’acteurs cherchent à inscrire leurs activités dans le respect des limites planétaires, tout en répondant aux attentes sociales et sociétales. Des entreprises plus importantes comme Bel ou Amarenco s’engagent déjà dans cette direction, en intégrant par exemple la triple comptabilité dans leur pilotage stratégique.
Pour autant, plusieurs freins à la généralisation de ces modèles subsistent. Beaucoup d’initiatives demeurent encore tributaires d’incitations réglementaires (comme la CSRD ou le devoir de vigilance) ou de pressions externes (attentes des consommateurs, investisseurs). Peu atteignent une maturité pleinement régénérative, combinant simultanément la réduction des impacts négatifs à des seuils incompressibles, la création d’impacts positifs nets sur les écosystèmes et les communautés, et une approche systémique de leur modèle d’affaire.
Pour accompagner leur montée en puissance, plusieurs leviers apparaissent décisifs :
- Renforcer les moyens financiers et humains pour soutenir l’innovation, la transformation des chaînes de valeur ou l’investissement dans des pratiques régénératives (écoconception, énergies renouvelables, outils de mesure d’impact…).
- Développer des écosystèmes de soutien, incluant des plateformes collaboratives, des fonds d’investissement orientés vers la régénération, et des mécanismes de mutualisation des risques entre acteurs engagés.
- Favoriser un changement culturel profond, en valorisant les compétences transversales, la coopération intersectorielle et des formes de gouvernance plus participatives.
Enfin, il est essentiel de rappeler que la régénération est un chemin plus qu’un état : elle suppose une démarche volontaire, un apprentissage continu, et une posture d’humilité face à la complexité du vivant. Le terme même de « visée régénérative » que nous employons reflète cette orientation. Les projets étudiés constituent autant de repères inspirants pour celles et ceux qui souhaitent s’engager, en démontrant que l’économie régénérative est non seulement possible, mais déjà en construction.
Les signaux faibles d’aujourd’hui sont les standards de demain. Il ne tient qu’à nous de créer les conditions pour qu’ils se diffusent à grande échelle – dans un esprit de co-construction, d’expérimentation et de confiance partagée.