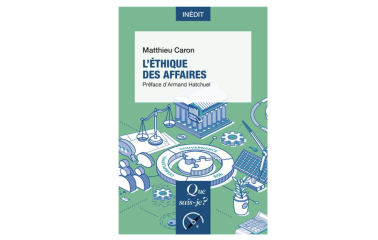En moyenne, l’empreinte carbone d’un Français atteint 9 tonnes d’équivalent CO₂ par an, soit cinq fois plus que l’objectif visé pour contenir le réchauffement climatique. Pourtant, l’engagement proclamé pour la durabilité ne faiblit pas. Ce décalage persistant, connu sous le nom de green gap, intrigue : pourquoi nos comportements ne suivent-ils pas nos convictions ?
C’est la question à laquelle ont tenté de répondre Stéphane Borraz, enseignant-chercheur à NEOMA Business School et son co-auteur, en menant une trentaine d’entretiens auprès de citoyens engagés, à la fois dans leur vie professionnelle et associative. Invités à calculer leur propre empreinte carbone, les participants ont ensuite été interrogés sur la façon dont ils vivaient — et justifiaient — l’écart entre leurs actes et leurs ambitions climatiques.
Trois types de justifications, sans déni de responsabilité
Loin de se dédouaner, les personnes interrogées ont mobilisé plusieurs types de justifications :
- Une critique de l’outil : l’empreinte carbone est perçue comme abstraite, mal adaptée aux réalités individuelles ou peu incitative. Difficile de se représenter concrètement ce qu’est une tonne de CO₂ au quotidien.
- Un rejet idéologique : certains estiment que l’empreinte carbone individualise un problème systémique et qu’elle détourne l’attention d’une transformation collective nécessaire. D’autres indicateurs comme la biodiversité, l’usage des sols ou l’eau sont également jugés cruciaux.
- Un sentiment d’injustice : beaucoup perçoivent un déséquilibre entre leurs efforts et ceux des autres — citoyens, entreprises ou gouvernements —, nourrissant frustration et repli.
Réduire le fossé : des pistes d’action concrètes
Pour transformer ces blocages en leviers d’action, les chercheurs formulent plusieurs recommandations:
- Rendre la mesure plus concrète et engageante : développer des outils de calcul carbone compréhensibles, contextualisés, et capables d’accompagner les choix du quotidien.
- Agir sur la perception d’équité : instaurer des politiques publiques plus justes, intégrant des incitations et des tarifications différenciées selon les capacités de chacun.
- Élargir les indicateurs : mieux prendre en compte d’autres dimensions de la transition écologique au-delà du seul prisme CO₂.
En résumé, selon l’étude, le green gap ne résulte pas d’un désintérêt pour la planète, mais d’un tiraillement entre volonté individuelle, contraintes systémiques et perception de justice. Réduire cet écart passe par des outils, des récits et des politiques qui reconnectent les citoyens à leur pouvoir d’action réel — et à leur rôle collectif dans la transition écologique.