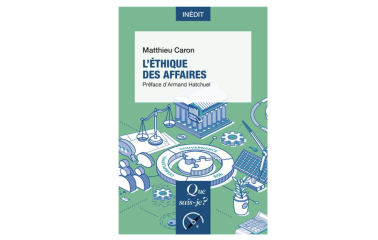Dans un contexte de chute drastique du nombre de populations d’animaux sauvages, de dépendances accrues des entreprises aux ressources naturelles et d’attentes salariales et sociétales renforcées, la préservation de la biodiversité s’impose comme un enjeu stratégique pour les entreprises. Au croisement des enjeux écologiques, sociaux et économiques, elle conditionne la soutenabilité des modèles productifs, l’engagement des collaborateurs et la viabilité des territoires.
Lors du Club Circul’R du 5 juin 2025, Gaspard Koenig, écrivain et philosophe, Aurore Falque-Pierrotin, CEO et co-fondatrice de Darwin, João Pereira da Fonseca, Head of Biodiversity Footprint Assessment chez CDC Biodiversité et Thomas Breuzard, Directeur Permaentreprise du groupe Norsys et Hortense Brunier, Directrice du Club Circul’R ont partagé leurs retours d’expérience pour mieux articuler économie circulaire et mesure de la biodiversité, afin de déployer des modèles réellement compatibles avec le vivant.
1. Intégrer le vivant dès la conception
L’économie circulaire vise à optimiser l’usage des ressources, mais elle ne garantit pas automatiquement la préservation des écosystèmes. Pour que la circularité devienne un levier de préservation, il est indispensable de prendre en compte les impacts sur le vivant dès la conception des produits et des services. Cela suppose, par exemple, de privilégier des matériaux dont l’extraction et la transformation n’engendrent pas de déforestation ou de pollution de l’eau d’augmenter la durée d’usage pour limiter la pression sur les milieux naturels.
Comme l’a souligné João Pereira da Fonseca, la biodiversité est par nature locale, contextuelle et multifactorielle. Un même procédé peut avoir des effets très différents selon le territoire où il est déployé. Il ne suffit donc pas de réduire les volumes extraits ou les déchets produits : il faut s’aligner sur le fonctionnement du vivant, en s’inspirant des écosystèmes pour imaginer des modèles réellement compatibles avec leurs dynamiques.
2. Mesurer son impact biodiversité pour mieux orienter l’action
Contrairement aux émissions de gaz à effet de serre, qui se traduisent en équivalents CO₂ relativement standardisés, la biodiversité ne peut être réduite à une seule métrique. Elle englobe des dimensions multiples : diversité génétique, richesse en espèces, fonctionnement des écosystèmes… autant de composantes interdépendantes, souvent invisibles, toujours territorialisées.
Le défi réside dans cette complexité : il faut des indicateurs adaptés à chaque contexte local et à chaque secteur d’activité. C’est ce que propose le Global Biodiversity Score (GBS), un outil développé par CDC Biodiversité, qui permet d’évaluer l’empreinte biodiversité d’une organisation sur l’ensemble de sa chaîne de valeur. Le GBS identifie les principales pressions exercées sur le vivant (usages des sols, extractions, pollution, etc.) et donne aux entreprises une vision globale de leurs impacts directs et indirects.
De son côté, la start-up Darwin a conçu une plateforme SaaS qui permet aux entreprises de cartographier à la fois leurs dépendances à la biodiversité (eau, pollinisation, régulation naturelle, etc.) et leurs impacts sur celle-ci. L’objectif : fournir une base solide pour construire des plans d’action opérationnels, ciblés et mesurables.
Ces outils ne sont pas de simples tableaux de bord : ils permettent de révéler des zones d’impact souvent méconnues, comme l’artificialisation induite par l’extraction de matières premières ou les effets en cascade dans les chaînes d’approvisionnement. En rendant visible ce qui ne l’est pas toujours, la mesure devient un catalyseur de transformation. Elle permet aussi aux entreprises de communiquer sans greenwashing sur la réduction de leur pression sur le vivant.
3. S’inspirer du vivant pour réinventer la gouvernance
Face à l’ampleur des défis environnementaux, certaines entreprises font le choix de transformer leur mode de gouvernance en y intégrant explicitement les enjeux du vivant. C’est le cas du groupe Norsys, qui a mis en place une mesure inédite : la nomination d’un représentant de la nature au sein de son conseil d’administration. Doté d’un droit de veto sur les décisions à fort impact écologique, ce représentant incarne symboliquement et juridiquement la voix des écosystèmes dans les choix stratégiques.
En influençant les trajectoires de projets, cette gouvernance du vivant favorise des choix plus sobres et replace les enjeux environnementaux au même niveau que les considérations économiques et sociales. Dans une logique d’économie circulaire régénérative, elle ouvre la voie à des modèles d’affaires fondés sur la coopération avec le vivant, plutôt que sur son exploitation.
4. Créer des synergies entre filières pour agir collectivement
La biodiversité ne s’arrête pas aux frontières d’une entreprise. Elle est systémique, territoriale, et traversée par une multitude d’interdépendances. Pour agir efficacement, les entreprises doivent mobiliser l’ensemble de leur chaîne de valeur, de la production à la distribution, en passant par la logistique, les achats et le design produit.
Cela implique de co-construire des outils communs (indicateurs, standards, méthodologies, etc.) à l’échelle des filières, afin de garantir la traçabilité, rendre les impacts visibles, comparables et actionnables. Sans collaboration, les efforts restent fragmentés.
Les échanges du Club Circul’R ont mis en lumière la nécessité d’une coopération étroite entre grands groupes, startups, institutions publiques et territoires. Car si les impacts sont globaux, les solutions doivent être ancrées localement, de manière collaborative, en lien avec les écosystèmes spécifiques et les parties prenantes du terrain. C’est dans cette articulation entre vision systémique et action locale que réside la force de l’économie circulaire appliquée à la biodiversité.
5. Mobiliser les leviers financiers et culturels
Le financement de la biodiversité reste l’un des principaux angles morts de la transition écologique. Si les intentions se multiplient, les flux d’investissement restent encore très éloignés des besoins réels. Les crédits biodiversité, bien qu’imparfaits et encore en phase d’expérimentation, offrent une première piste pour canaliser des ressources vers des projets de régénération : reforestation, restauration de zones humides, solutions fondées sur la nature, etc.
Mais pour que ces enjeux s’ancrent durablement dans les stratégies, ils doivent aussi parler le langage de l’entreprise. Par exemple, associer des indicateurs biodiversité aux bonus des salariés, comme l’impact eau/€ d’achat ou le ratio surface artificialisée/CA, facilite leur intégration dans les outils de pilotage et mobilise les fonctions clés (finances, achats, direction).
Enfin, comme l’a rappelé Gaspard Koenig, une transformation véritable ne peut être uniquement structurelle. Elle est aussi culturelle. Il s’agit de faire évoluer notre rapport à la nature : la voir non plus comme un risque à éviter ou une contrainte à compenser, mais comme une source d’inspiration, de sens et de désir. Réapprendre à habiter le monde, à s’émerveiller de ce qui dure, pousse, se régénère. Une écologie du lien plutôt que du renoncement, qui donne envie d’agir, individuellement et collectivement.
____________________
Le Club Circul’R en bref
Lancé en 2018 avec le soutien du ministère de la Transition Ecologique, le Club Circul’R réunit une centaine d’acteurs économiques (grands groupes, acteurs financiers, éco-organismes, porteurs de solutions) engagés dans la transition vers une économie circulaire. Son objectif : activer les collaborations afin d’accélérer le passage vers des modèles circulaires. Pour en savoir plus, rendez-vous Club Circul’R ou contactez Diane Cadet Fauvel (diane.cadetfauvel@circul-r.com).
Prochain rendez-vous du Club Circul’R : 2 octobre 2025 au ministère de l’Economie et des Finances sur la thématique des modèles d’affaires circulaires.