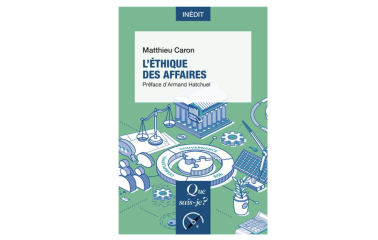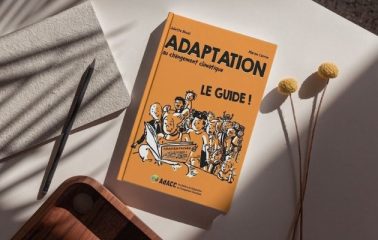Connaissez-vous le WGWG ? « « White guy with guns » est le nouveau motto en vogue à Hollywood et il n’y a que ça qui marche en ce moment », nous apprend Elodie Namer.
Cette scénariste qui a travaillé notamment sur les séries « Les Randonneuses » (sur TF1) ou « Le diplôme » (M6), tout juste revenue d’un séjour dans la cité des anges, participait à un débat sur la contribution de la fiction à l’écologie lors de la Climate & Nature week organisée par SciencesPo Paris du 27 au 29 octobre derniers.
Autant dire que ne cela ne laisse pas plus de place aux messages inclusifs vis-à-vis des minorités qu’à l’écologie. Le bonheur et la réussite restent associés à des comportements consuméristes et le « pétrovirilisme », qui fait de personnages masculins au volant de bolides rapides et bruyants les emblèmes de la virilité, a plus que jamais le vent en poupe.
Outre-Atlantique, « Landman », série construite autour d’un récit conservateur dans le monde des plateformes pétrolières au Texas, qui propage des messages alignés avec l’industrie pétro-gazière qui la sponsorise, fait un carton.
Seules 5% des séries ont l’environnement comme thème central
« C’est vrai aussi que le « monde d’après » n’est guère mobilisateur », reconnaît Olivier Szulzynger, scénariste aux manettes de « Plus belle la vie » et « Un si grand soleil » sur France TV. Certains mots tels qu’écologie, précisément, effraient les diffuseurs, soucieux de distraire les téléspectateurs qui n’auraient pas envie de retrouver dans les séries les mêmes sujets anxiogènes que dans les JT. Pourtant, d’après une étude Netflix, ils aimeraient voir ces sujets plus traités dans les programmes de fiction.
Mais mieux vaut faire preuve de subtilité et éviter de les aborder trop frontalement en faisant de l’écologie LE sujet central. C’est d’ailleurs ce que montre le baromètre de l’écologie dans la fiction audiovisuelle française publié en septembre dernier par l’Observatoire de la fiction, créé en 2024. Siles scénarios tournant entièrement autour de ce sujet sont rares (5 %), 60 % des programmes contiennent au moins une ligne de dialogue sur l’environnement ou le changement climatique, portés par une grande diversité de profils.
En revanche, on voit peu de métiers de la transition écologique, d’artisans faisant des livraisons en vélo cargo, etc. C’est un peu moins vrai dans les séries quotidiennes, qui mettent en scène des gens qui s’occupent de leurs potagers, des garages à vélos, etc. Charles Ménard et Éléonore Gueit, cofondateurs de l’Observatoire, suggèrent que les collectivités s’emparent du sujet. « Elles font beaucoup pour valoriser leurs territoires dans les fictions, mais pourraient dans le même temps valoriser leurs initiatives et celles de leurs habitants. »
Des briques de narratifs issues du terrain à disposition des scénaristes
Olivier Szulzynger est conscient que son rôle à la tête d’une série quotidienne lui permet « de faire entrer chez les téléspectateurs des préoccupations du quotidien ». Mais en jouant sur des ressors plus émotionnels que techniques.
« Le problème vient plus de nos propres biais que des diffuseurs », reconnaît-il. Et de citer le week-end en avion qui vient systématiquement marquer le début de toute nouvelle histoire d’amour (nombreuses dans les séries).
Soucieuse de fournir des outils concrets, l’association « Nouvelle séquence », qui rassemble des scénaristes souhaitant ménager une place plus importante à ces sujets dans la fiction, dont Elodie Namer et Olivier Szulzynger, a choisi l’agriculture comme terrain de jeu, parce que c’est un monde qui « concentre l’essentiel des enjeux écologiques actuels ».
« Nouvelle séquence » a multiplié les rencontres avec des agriculteurs pour mieux cerner la diversité des situations – au-delà du cliché de l’exploitant endetté et dépressif – et des motivations des uns et des autres. Il en résulte un document en open source mettant à disposition des scénaristes des briques de narratifs.
D’autres boîtes à outils sont disponibles pour définir ce que serait une série « responsable », dans le cadre de collaborations à l’international, notamment avec des scénaristes anglo-saxons, y compris américains. « Nous devons collectivement apprendre à naviguer au sein du WGWG », conclut Elodie Namer.