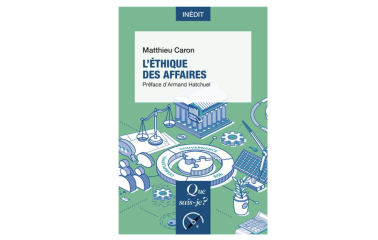L’intelligence artificielle, notamment générative mais aussi argentique ou robotique, fait quotidiennement la Une des médias. Cette omniprésence reflète son impact sur l’économie, le monde du travail et même les marchés financiers… En effet, l’éventualité d’une bulle, que certains comparent à celle d’Internet à la fin des années 1990, se fait de plus en plus menaçante.
Cette crainte résulte des sommes colossales investies par les géants du numérique, alors même que l’intelligence artificielle est loin d’avoir fait la preuve de sa rentabilité financière. Quelque 1500 milliards de dollars devraient ainsi être engloutis dans les infrastructures en 2025. Le fabricant de puces Nvidia a franchi cet automne la barre des 5000 milliards de dollars de valorisation boursière. Pourtant, un rapport du MIT d’août 2025 évaluait à 5% seulement les entreprises utilisatrices qui en tiraient profit sur le plan économique, et OpenAI (ChatGPT) devrait afficher pour 2025 une perte de 7 milliards de dollars.
Ce qui n’empêche pas certaines d’entre elles (à l’instar d’Amazon qui a annoncé 14 000 départs dans le monde fin octobre) de licencier massivement en invoquant la capacité de l’IA à remplacer ces dizaines de milliers de postes. Les jeunes diplômés sont les premiers à en faire les frais, avec une baisse d’un tiers des recrutements depuis janvier 2024, qui devrait se poursuivre ces prochaines années aux dires de employeurs.
Une potentielle bulle financière et des destructions massives d’emplois ne sont pas les seules incertitudes que suscite la généralisation de l’IA : des talents de créatifs particulièrement menacés, à l’instar de 15 000 doubleurs dans le cinéma ; des conséquences encore mal connues d’un recours intensif à l’IA sur nos capacités cognitives, en particulier celles des jeunes générations ; un risque accru en termes de cybersécurité ; un outil favorisant la désinformation…
Les données opaques d’un impact écologique gigantesque
Face à cette avalanche de bouleversements, on finirait par en oublier l’impact environnemental. Difficiles à évaluer précisément, le surcroît de consommation électrique pour entraîner les IA, alimenter et refroidir les data centers ; les émissions de CO2 associées et la pression sur la ressource en eau ou les matériaux critiques indispensables à la fabrication des semi-conducteurs, pourraient prendre des proportions gigantesques, voire insoutenables dans certains cas.
De nombreux rapports affichent des projections alarmantes : Accenture annonce une consommation électrique mondiale décuplée d’ici à 2030 et une multiplication par 11 des émissions ; en France, malgré un mix électrique particulièrement décarboné, la consommation des data centers pourrait voir sa part dans la consommation nationale multipliée d’un facteur de 7 à 13 et faire jeu égal avec celles du secteur cimentier. Selon The Shift Project, les émissions mondiales du numérique pourraient croître de 9% par an dans les cinq prochaines années pour atteindre deux fois celles de la France.
Les acteurs du secteur eux-mêmes reconnaissent que l’IA menace leurs engagements de neutralité carbone et que leur consommation d’eau s’est accrue de 20 à 30% ces deux dernières années. Celle-ci pourrait atteindre de quatre à six fois celle du Danemark d’ici à 2030. L’impact sur l’écosystème des data centers sous-marins, moins gourmands en énergie pour les refroidir, reste méconnu.
Ces projections sont d’autant plus inquiétantes qu’au niveau local, elles peuvent conduire à des conflits d’usage, pour l’électricité comme pour l’eau. Cela commence déjà à être le cas en Irlande, où les data centers pèsent 22% de la demande en électricité ; la situation pourrait devenir ingérable dans certains états américains déjà menacés de stress hydrique.
En France aussi, plusieurs projets d’une puissance supérieure à 1 gigawatt (GW), soit l’équivalent d’une centrale nucléaire, prévus dans le plan à 109 milliards annoncé en février 2025 lors du Sommet pour l’IA, risquent d’entraîner des tensions sur le réseau.
Mais l’opacité sur les consommations réelles des infrastructures de calcul, l’hétérogénéité des modalités et des périmètres de mesures et l’absence de normes rendent impossibles une évaluation précise de ces impacts. Selon Accenture, qui a élaboré un outil multicritère ad-hoc, seules 14% des entreprises se sont dotées d’outils de mesure et d’une stratégie visant à s’assurer d’un usage responsable de l’IA.
L’IA au service de l’environnement, une piste encore peu explorée
Difficile, dans ces conditions d’identifier les principaux gisements d’économies. Pourtant, des solutions existent à tous les niveaux de la chaîne de valeur, de la fabrication des puces à l’alimentation des data centers en électricité verte ou au free-cooling pour les refroidir de façon plus naturelle.
Mais une source d’économies importante reste à ce jour peu explorée : l’utilisation de modèles adaptés aux différents cas d’études, y compris en combinant plusieurs agents grâce à des intégrateurs. Le principe « on the hedge », utilisé par exemple pour une aide à la conduite assistée embarquée dans le véhicule après avoir entraîné le modèle dans le cloud, permet aussi de limiter l’impact.
Cependant, la tendance dominante consiste à utiliser un marteau pour tuer une mouche, autrement dit, de larges modèles très gourmands, moyennement efficaces de surcroît pour répondre à un besoin spécifique.
« Au même titre que le numérique, y compris le plus élémentaire, l’IA est nocive pour l’environnement », affirme Frantz Gault, qui représente la nature au Conseil d’administration de norsys. « Mais il n’y a ni touche « stop », ni marche arrière possible », alerte Chantal Jouanno, senior adviser chez Accenture, co-autrice de l’étude « Le défi environnemental de l’IA » réalisée dans le cadre du cercle de Giverny.
C’est donc la finalité du recours à l’IA qui doit être interrogée de façon beaucoup plus systématique. « La vraie question est d’évaluer si le bien généré en aval grâce à l’IA compense le mal fait en amont, au regard de l’impact de cette technologie sur les 9 limites planétaires, précise Frantz Gault. Or il n’existe aucun outil permettant d’établir ce diagnostic, même si le Stockholm Resilience Center (à l’origine du concept des limites planétaires) travaille sur un modèle expérimental testé auprès de quelques entreprises, dont norsys. »
Le marché de la santé, qui devrait passer de 29 à 500 milliards de dollars d’ici à 2032, est un secteur où son efficacité semble prouvée, aussi bien pour des raisons scientifiques qu’éthiques.
Or en parallèle, 60% des 18/25 ans utilisent l’IA en lieu et place d’un moteur de recherche, tandis que seules 14% des entreprises l’exploitent comme un levier de décarbonation.
Ce que déplore Julien Fanon, directeur exécutif en charge de l’activité RSE d’Accenture, alors que de multiples cas d’usages restent à explorer. Par exemple pour de meilleures modélisations dans la science du climat, une meilleure détection des fuites de méthane ou de la criminalité environnementale, une meilleure gestion énergétique des bâtiment et parcs immobiliers, une meilleure gestion des flux de biens et de personnes, etc.