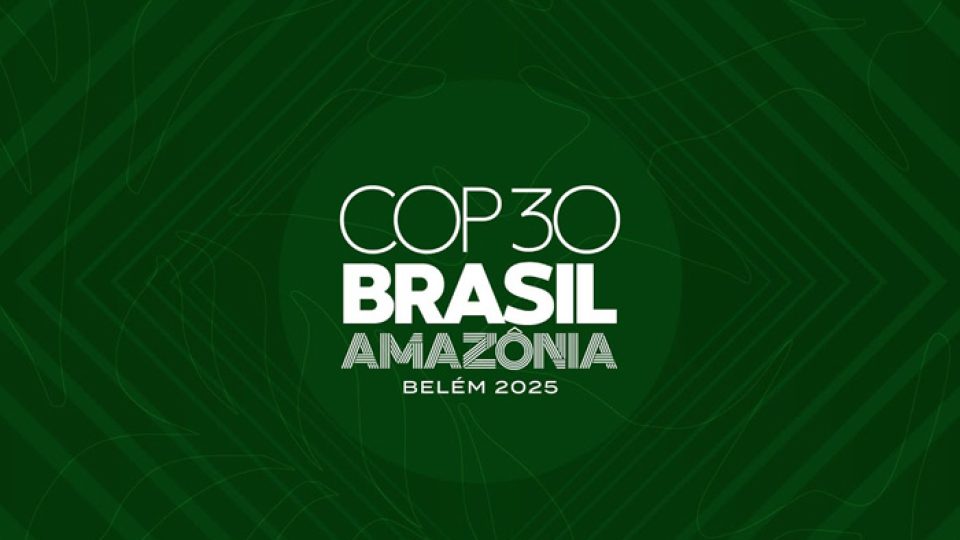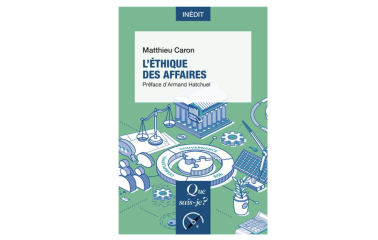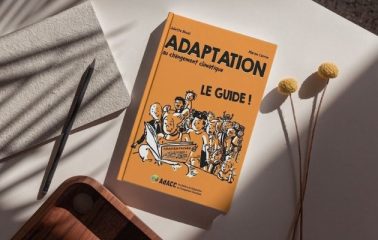Les artisans de l’accord de Paris, dont l’adoption avait été marquée par le coup de maillet du président de la COP21 Laurent Fabius au Bourget le 12 décembre 2015, auraient sans doute rêvé d’un autre contexte pour célébrer le dixième anniversaire du premier traité international de réduction des émissions de gaz à effet de serre, embarquant notamment les grands pays émergents.
Non seulement les conflits militaires et économiques ont pris le pas sur le climat, mais la COP30, organisée par le Brésil à Belém en Amazonie du 10 au 21 novembre, survient en plein backlash écologique. Attisé depuis son retour au pouvoir par un président des États-Unis ouvertement climato-sceptique, ses effets se font sentir dans le monde entier.
Comme en 2017, Donald Trump a annoncé se retirer de l’accord de Paris alors que les États-Unis sont le deuxième plus gros émetteur de gaz à effet de serre avec 10% des émissions mondiales, après la Chine qui en représente 27%. Ce retrait ne sera effectif qu’en janvier 2026, mais il n’y aura pas de représentant américain de haut-niveau à Belém.
L’engagement tardif et frileux de l’Union européenne
L’Union européenne elle-même, traditionnellement à l’avant-garde de la transition écologique, n’a réussi à s’entendre sur une trajectoire de baisse de ses émissions qu’à quelques jours du début de la COP30 et au terme d’âpres négociations. Et sa CDN (contribution décidée au niveau national), ou NDC (nationally determined contribution) dans le langage onusien, est jugée insuffisante par nombre d’observateurs. L’objectif de -90% d’émissions en 2040 (par rapport à l’année de référence 1990) est maintenu, mais c’est une fourchette entre -66,25 et -72,50% qui sera soumise à Belém pour 2035, en raison de nombreuses dissensions entre États-membres encore très dépendants aux énergies fossiles, essentiellement en Europe de l’Est, et d’autres plus volontaristes tels que l’Espagne.
Et cet accord n’a été obtenu qu’au prix de concessions telles que le report d’un an de l’extension du marché européen du carbone au carburant routier et au chauffage des bâtiments et un mécanisme de flexibilité autorisant les États-membres à recourir à des crédits carbone internationaux (hors UE) pour 5% de leur engagement. Ce dispositif, qui abaisse de facto l’ambition européenne à 85% en 2040, a été poussé notamment par la France, qui avait également exigé, et obtenu, le soutien à l’énergie nucléaire et des mesures de sauvegarde pour l’acier européen. Est également prévue une clause de révision sur cet objectif en 2030, et un mécanisme de « frein d’urgence » en cas de sous-performance (très probable) des puits de carbone naturels, océans et forêts, eux-mêmes victimes du changement climatique.
Autant de concessions critiquées par les ONG, alors que les dommages imputables au changement climatiques se font toujours plus dramatiques. Que ce soit en matière de pertes matérielles (300 milliards d’euros dans le monde en 2024) ou humaines, avec 550 000 décès annuels attribués à la chaleur par le Lancet Countdown. Le Emission gap report du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUD) établit à 25 ans, au rythme actuel, le volume d’émissions que l’humanité peut encore se permettre avant de dépasser le plafond de réchauffement de 2°C inscrit dans l’accord de Paris…
Dix ans d’acquis mais des avancées trop lentes
Pour autant, faut-il passer ces dix dernières années par pertes et profits ? Certes, les émissions ont continué à croître depuis dix ans (+2,3% en 2024) et le réchauffement s’est même accéléré ; mais les engagements actuels, à condition qu’ils soient tenus, amènent à un réchauffement de +2,3 à 2,5°C. C’est beaucoup trop, à en juger par les effets du changement climatiques déjà observés alors même que les +1,5°C ne sont pas encore officiellement dépassés. Mais avant l’accord de Paris, cette trajectoire aurait abouti à une hausse de +4°C.
Les prix des énergies renouvelables ont connu une baisse vertigineuse. Désormais moins chères que les nouvelles centrales à charbon et à gaz dans presque tous les marchés, elles ont représenté 70% de la demande électrique mondiale ces dix dernières années. Malheureusement, elles s’ajoutent aux énergies fossiles plutôt qu’elles ne s’y substituent.
Sur le front de la finance climat, l’engagement pris par les pays « du nord » en 2009 à Copenhague, de dégager chaque année 100 milliards de dollars pour aider la transition des pays « du sud », atteint en 2022 avec deux ans de retard et composé de prêts plus que de dons, a été légèrement dépassé l’an dernier. En revanche, celui pris à la COP29 de 2024, de 300 milliards de dollars par an, avait été jugé très inférieur aux besoins et devra être révisé à Belém.
Globalement, la prise de conscience de la réalité du changement climatique a nettement progressé depuis l’accord de Paris. De nombreux pays ont établi des stratégies climat, ont soumis des NDC à l’horizon 2030 et se sont engagés à la neutralité carbone en 2050 ou 2070, tout comme de nombreux acteurs non étatiques.
Une place accrue pour la société civile…et le multilatéralisme ?
La COP21 avait été la première à réserver une place significative à la société civile et au secteur privé (entreprises et finance). De multiples initiatives menées par toutes sortes de coalitions avaient vu le jour au sein de « l’agenda des solutions ». La COP30, qui se veut une « COP de l’action », sera l’occasion d’en tirer un premier bilan. L’implication des acteurs non étatiques s’est notamment concrétisée par une forte présence des élus locaux, qui se traduit par la présence à Belém d’une centaine de gouverneurs et maires de grandes villes américaines.
L’accord de Paris a également été la base de nombreux procès en inaction climatique intentés ces dernières années (de 200 à 300 par an). La Cour internationale de justice a conclu en juillet dernier que les États violant leurs obligations contraignantes relevant de l’accord de Paris, pourraient se voir réclamer des réparations par les pays les plus affectés.
Outre la soumission de NDC plus ambitieuses, que l’accord de Paris prévoit tous les cinq ans, les participants à la COP30 devront se pencher sur plusieurs dossiers. Notamment une feuille de route “Baku-to-Belém” visant à débloquer d’ici 2030 une enveloppe annuelle de 1 300 milliards de dollars de flux financiers Nord/Sud ; l’élaboration de cibles en matière d’adaptation et de financements pour les fonds Adaptation et Pertes et dommages ; une initiative du Brésil en faveur des forêts, le Tropical Forest Forever Facility (TFFF), visant à mobiliser 125 milliards de dollars.
Sous la présidence du Brésilien André Corrêa do Lago, vétéran respecté des négociations climatiques, cette COP30 devrait redonner de l’air à une société civile bâillonnée lors des précédentes COP, avec le retour de la traditionnelle marche pour le climat de mi-sommet et la place accordée aux peuples autochtones. Mais aussi rassembler largement les pays « du sud ». De quoi renforcer un multilatéralisme plus affaibli que jamais depuis la ré-élection de Trump ?
Face à lui, ses récentes tergiversations ont fait perdre à l’Union européenne son rôle de leader climatique, et l’engagement de la Chine (réduire ses émissions de 7 à 10% entre son pic et 2035) a déçu. Pourtant, les plus optimistes veulent voir dans les avancées obtenues suite au sommet sur les océans de Nice en juin dernier, notamment la ratification du Traité sur la Haute mer, quelques motifs d’espérer en la matière.
Quid du rôle des entreprises ?
« Les COP doivent aussi servir à reconnaître le rôle des entreprises en tant qu’apporteuses de solutions. Sans elles, il n’y aura pas de décarbonation. Les entreprises sont prêtes à contribuer aux 1 300 milliards de financements, mais ce ne sera pas de la philanthropie. Les puits de carbone naturels, sur lesquels travaille beaucoup l’UNESCO, constituent une piste à approfondir. Comme d’autres acteurs engagés dans la décarbonation, les entreprises qui ont investi craignent plus que tout un retour en arrière. Elles veulent de la régulation, mais aussi être associées aux discussions afin d’éviter des textes inapplicables — comme ce fut le cas du règlement européen sur la déforestation — et de ne pas subir de distorsions de concurrence », souligne Nils Pedersen, délégué général du Pacte Mondial de l’ONU / Réseau France.