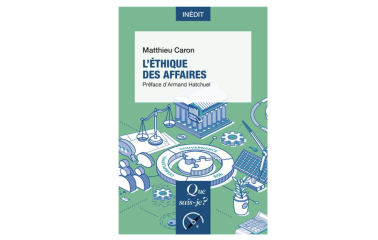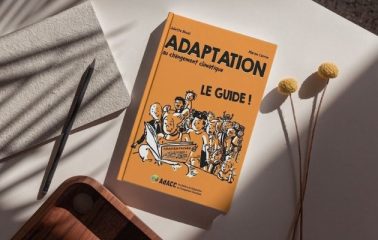Le spectacle est tout à la fois magique, symbolique et désolant. Nous sommes, en cette mi-avril, au chevet du plus grand glacier naturel de France, la Mer de Glace. Au niveau de la célèbre grotte, toujours visitée par près de 450 000 touristes chaque année, les effets du réchauffement climatique ne s’imaginent plus, ils se vivent. Dans les Alpes et les Pyrénées, les glaciers fondent plus vite que n’importe où ailleurs dans le monde. La glace cède ici, et depuis des années déjà, peu à peu sa place aux roches et aux cailloux, transformant profondément le paysage, comme le tourisme et l’activité économique…
« Depuis 1880, la température moyenne a augmenté de 1,2°C à l’échelle de la planète, explique le géomorphologue glaciaire, géographe et glaciologue, Sylvain Coutterand, qui nous accompagne sur le désormais tristement surnommé « glacier noir ». Mais elle a augmenté d’environ 2,4°C à Chamonix. La situation est très préoccupante ». La Mer de Glace agonise (elle a reculé de 900 mètres depuis 1993!) et l’avenir de tous les glaciers du massif du Mont-Blanc est sous surveillance constante. « Les rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) sont clairs : nous avons encore une courte fenêtre pour agir », écrit le glaciologue dans son dernier ouvrage, Les glaciers du Mont-Blanc vont-ils disparaître ?, paru en juillet 2024 aux éditions Esope. « Chaque action a le potentiel de faire une différence ».
Mais pourquoi tant d’inquiétudes pour les glaciers et la haute montagne ?
Les glaciers, comme les territoires de montagne et de haute montagne, sont des écosystèmes à préserver d’urgence. D’abord, parce que la température y augmente encore plus vite qu’ailleurs, « mais aussi parce qu’ils jouent un rôle dans la régulation du climat. Ils sont les lieux de préservation du permafrost, le point de départ de nombreuses sources d’eau douce (lacs et rivières), le berceau d’espèces endémiques de faune et de flore, ou encore le bassin d’une forte activité économique (centrales hydroélectriques, approvisionnement en eau potable, tourisme, etc.) », explique Véronique Vidal de la Blache, chargée de projet « 2025 année de préservation des glacier », pour la Communauté de communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc. Ce territoire est donc entré, cette année, dans un projet international spécifique initié par les Nations Unies.
Flocon Vert fédère les acteurs de la montagne depuis 15 ans
D’autres initiatives ont déjà vu le jour pour préserver les zones de montagne et fédérer la diversité de leurs acteurs, depuis les éleveurs et agriculteurs, jusqu’aux élus, aux exploitants de remontées mécaniques et aux hôteliers. « Nous avons lancé le label Flocon Vert en 2010 et décerné les premières labellisations de stations dès 2013, explique Camille Rey – Gorrez, directrice de Mountain Riders. C’est une démarche de progrès collective qui s’articule autour d’axes forts (préservation des ressources, enjeux socio-culturels, économie locale, gouvernance et stratégie), portée par les territoires et tirée par un cahier des charges qui évolue en fonction du changement climatique et des nouveaux besoins d’adaptation ».
Une quarantaine de territoires sont aujourd’hui inscrits dans cette démarche sur tous les massifs français, sur un total d’environ 250 stations en France. « Trente sont labellisés (et ont obtenu 1 à 2 flocons verts) et 10 sont en cours de labellisation, ajoute la présidente de l’association. L’idée est d’embarquer un maximum d’acteurs en même temps dans cette démarche et de sensibiliser tous les publics, population locale comme visiteurs ».
Accélérer les labellisations d’ici les JO d’hiver 2023
« Le 3e flocon est un niveau d’exemplarité qu’aucun territoire n’a encore atteint », ajoute Camille Rey – Gorrez. Mais de nombreuses stations aimeraient être parmi les premières à l’obtenir, tant le Flocon Vert devient peu à peu un témoin d’engagement. Même s’il reste plutôt méconnu du grand public (notamment chez les pratiquants des sports d’hiver), il tend à gagner en notoriété et, donc, à devenir, demain, un argument de différenciation et de choix de destination pour les touristes désireux de préserver la montagne, tout en continuant de pratiquer, hiver comme été, leurs diverses activités telles VTT, randonnée ou ski. L’ambition de Mountain Riders est de voir une dizaine de stations et sites devenir détenteurs de 3 Flocons Verts d’ici aux Jeux Olympiques d’hiver de 2030 et 70 à 80 détenteurs des niveaux 1 et 2 de la labellisation. Le tout, sans bien-sûr changer ses critères d’attribution ni réviser le cahier des charges à la baisse, bien au contraire! Et de continuer à réauditer les titulaires de plus longue date tous les 5 ans pour ne pas les laisser s’endormir sur leurs flocons…
Ce qu’en disent les acteurs locaux
« L’obtention du Flocon Vert s’opère au bénéfice de toute la communauté, explique Éric Fournier, maire de Chamonix (commune détentrice de 2 Flocons Verts) et président de la Communauté de communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc. Cela nous challenge et, comme nous partageons aussi nos expériences entre territoires, nous progressons d’année en année. » Pour limiter les effets du réchauffement et s’adapter, Chamonix travaille notamment sur l’habitabilité et les risques naturels : inondations, hydrologie, effondrements rocheux, avalanches ainsi que l’augmentation des phénomènes et catastrophes naturelles. La commune souhaite aussi privilégier le logement permanent et social versus les résidences secondaires, touristiques et les investissements purement spéculatifs.
Les élus envisagent également de prendre une série de mesures sur le tourisme pour mieux garder les visiteurs sur des temps longs et décourager les excursionnistes à la journée, sans pour autant privilégier une politique de quotas. « Nous ne pourrons pas accueillir tout le monde dans les années à venir, constate le maire. Il nous faut réfléchir aux évolutions et à la durabilité du tourisme en montagne, notamment en hiver, et aller plus loin dans les mécanismes de régulation. Nous serons l’une des rares stations à avoir des taux d’enneigement garantis d’ici 20 ans et la pression touristique sera donc forcément de plus en plus forte pour notre territoire. » Une réflexion est en cours Il est notamment envisagé de créer des tarifs de remontées mécaniques plus favorables aux personnes séjournant plusieurs jours. Ou l’augmentation des tarifs de stationnement (voitures) en vuede favoriser les arrivées en train et les déplacements en transports en commun sur l’ensemble du domaine ; depuis la vallée, comme depuis le reste de la France…
Des exemples à suivre souligne à son tour Daniel Rodrigues, directeur de la Compagnie des guides de Chamonix. Les guides, comme les moniteurs de ski, sont sans doute les premiers à être directement impactés par les changements drastiques à opérer, dans leurs activités et dans l’accueil des touristes. « Nous avons réalisé notre premier bilan carbone en 2019 et réduit de 30% nos émissions de gaz à effet de serre (GES) depuis lors, ajoute le directeur. Nous avons, notamment, mis fin à toutes les activités proposées à plus de 60 km de Chamonix (alors que les expéditions lointaines restent l’une des offres best-sellers des guides, NDLR) et nous avons abandonné les prestations hyper polluantes d’héliski dès 2018. » Des décisions fortes, qui ne plaisent pas toujours aux clients qui ont un pouvoir d’achat et des souhaits de plus en plus importants, tout comme à certains guides, qui voient leur chiffre d’affaires sensiblement impacté…
Et partout en Savoie et Haute-Savoie, de Chamonix, à Val Thorens, en passant par les Châtel , comme dans tous les massifs français, des efforts colossaux sont consentis pour transformer et adapter les territoires de montagne, pour sensibiliser encore et toujours, notamment via le Flocon Vert, les professionnels comme les amateurs au long cours ou de passage. « A Saint Gervais nous avons investi, sur ces dernières années, plus de 50 millions d’euros pour imaginer un réseau de transports en commun public propre qui profite à tous : skieurs, curistes, habitants à l’année, écoliers (transports gratuits), travailleurs locaux, etc., détaille Jean-Marc Peillex, le maire de la commune. Nous avons réussi grâce à une nouvelle génération d’usages et de financements, et nous espérons que notamment grâce au Flocon Vert, cette initiative serve d’exemple à d’autres communes et territoires »… de montagne, ou même d’ailleurs, en France, en Suisse ou en Italie !