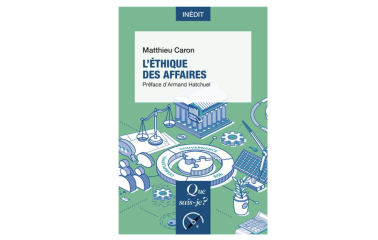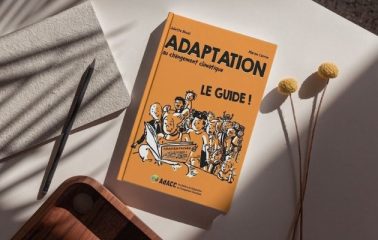« Personne ne pouvait penser que cette très grande démocratie du monde, dont le modèle économique repose si fortement sur la science libre, allait faire une telle erreur », dénonçait, Emmanuel Macron, le 5 mai dernier, lors d’une conférence à Paris visant à attirer, sur le territoire français et en Europe, les chercheurs « menacés » par le président américain. Une démarche entamée dans la foulée du mouvement Stand up for science né, en mars dernier, en soutien aux scientifiques américains, victimes d’attaques inédites de la part de l’hôte de la Maison blanche.
Sur de très nombreux sujets, ce qui se passe aux Etats-Unis depuis le retour au pouvoir de Donald Trump dépasse l’entendement. Sur le front de la désinformation, son premier mandat avait été marqué par l’avènement des « vérités alternatives » et sa propension à qualifier de « fake news » tout fait pourtant avéré mais ne trouvant pas grâce à ses yeux.
En amont du “lâchage” de l’Ukraine, qui a marqué le début de son second mandat, il n’a pas hésité à traiter le président ukrainien, Volodymyr Zelensky de « dictateur », à l’accuser de « vouloir la guerre », et à mentir au sujet de l’aide apportée par les Etats-Unis à l’Ukraine en annonçant à l’envi un montant deux fois supérieur à celui réellement versé. Quelques semaines auparavant, il avait accusé les migrants de manger les chiens et chats ; pendant les incendies qui ont ravagé Los Angeles, en janvier dernier, il a mis en cause le gouverneur – démocrate, assurant qu’il a invoqué la protection d’une espèce de poisson pour refuser de signer une « déclaration de restauration de l’eau » totalement imaginaire…
Tandis que l’agence Associated Press, qui refuse de rebaptiser le Golfe du Mexique Golfe de l’Amérique» est interdite d’accès à la salle de presse de la Maison Blanche, les créateurs de contenus sur TikTok et autres blogueurs ou podcasteurs, qui font office de nouveaux journalistes,[AM1] [MOU2] y sont désormais accueillis à bras ouverts.
De façon moins évidente, la suppression de l’aide américaine au développement va favoriser un peu plus la propagation de la désinformation dans le monde entier (voir encadré).
La suppression de l’USAid signe l’arrêt de mort de médias indépendants du monde entier
Parmi les projets soutenus par l’Agence américaine pour le développement international (USAid) dont Donald Trump vient de supprimer 84% des programmes, plus de 268 millions (247,6 millions d’euros) étaient dédiés au soutien des « médias indépendants et de la libre circulation de l’information ».
Selon une fiche d’information de l’USAid que Reporters sans frontières (RSF) a pu consulter avant qu’elle soit mise hors ligne, l’agence américaine a financé, en 2023, la formation de 6 200 journalistes, aidé 707 médias non étatiques et soutenu 279 organisations de la société civile dédiées au renforcement des médias indépendants dans plus de 30 pays, dont l’Iran, l’Afghanistan et la Russie. Autant de médias à but non lucratif contraints de licencier et de fermer boutique, et une porte grande ouverte à la propagande étatique.
Sur un autre terrain, le président américain a donc pris toute une série de mesures visant à couper les vivres, démanteler, et priver d’accès aux bases de données qui constituent leurs outils de travail, de nombreuses organisations scientifiques, œuvrant notamment pour la protection du climat. « Effacer et supprimer, c’est le stade ultime d’une désinformation institutionnelle au plus haut degré de l’Etat, qui prive les journalistes de sources », souligne Célia Gautier, fondatrice d’Expertises Climat, qui créé des ponts entre la recherche et les médias.
La désinformation n’est pas toujours aussi spectaculaire. Elle prend aussi la forme d’événements inventés de toutes pièces ou déformés, de relations de cause à effet sans aucun fondement, de résultats scientifiques falsifiés, partiellement reproduits, dépourvus de contexte, présentés selon des échelles prêtant à confusion…
Elle n’est pas l’apanage des seuls Etats-Unis et n’a rien non plus de très nouveau. Mais elle est aujourd’hui amplifiée par une conjonction de circonstances qui s’additionnent et se nourrissent les unes des autres. A commencer par l’hégémonie des réseaux sociaux.
L’enquête de L’Observatoire de la société et de la consommation (ObSoCo), la Fondation Jean Jaurès et Arte sur la “Fatigue informationnelle” de décembre 2024 ; le baromètre 2024 du Credoc sur le rapport des jeunes aux informations ; l’Eurobaromètre 2025 sur la jeunesse du Parlement européen… toutes ces études récentes convergent : les réseaux sociaux sont devenus la principale source d’accès aux actualités, un phénomène encore plus marquant chez les jeunes.
« Les plateformes jouent donc un rôle essentiel de kiosque », résume Benjamin Sabbah, responsable du programme Journalism Trust Initiative, né au sein de Reporter sans frontières. Il pointe « une contradiction entre leur fonctionnement, qui favorise l’émotionnel et le volume de réactions, et l’intérêt général, qui repose sur l’accès des citoyens à une information fiable ». En effet, elles sont régies par des algorithmes qui amplifient les effets de communautés en favorisant toujours plus les sujets clivants, ceux qui suscitent le plus de réactions positives comme négatives, synonymes de clics et de recettes publicitaires. Des mécanismes similaires propulsent les articles ou ouvrages les plus polémiques en tête des résultats effectués à partir de moteurs de recherche.
Le climat, terrain de jeu favori des complotistes
Cette situation est d’autant plus préoccupante que, sur les plateformes, à peu près n’importe qui peut dire à peu près n’importe quoi. « Là où il fallait auparavant une imprimerie ou une radio pour diffuser de l’information, les réseaux sociaux ont réduit le coût d’entrée à néant », témoigne Adrien Sénécat, membre de l’équipe des Décodeurs du Monde. « D’une majorité de sources professionnelles, on est passé à des para-professionnelles, puis à n’importe quoi, voire à des émetteurs malveillants », résume-t-il. Les réseaux sociaux créent une forme d’horizontalité, en mettant chaque émetteur sur le même plan. La succession de crises financière, économique, sanitaire ou encore environnementale des dernières années a fait le lit des fake news. Le climat et l’écologie, où les événements récents ont tendance à dépasser les projections scientifiques les plus alarmistes, sont aujourd’hui l’un des terrains de jeu favoris des complotistes. Notamment parce que c’est un sujet complexe et qui demande une réflexion sur le long terme. Mais aussi parce que la décarbonation, comme l’adaptation au changement climatique, impose des changements de modes de consommation, de vie, de société, en un mot, la fin du “business as usual”. Autant de limites à la liberté ; liberté individuelle aussi bien que liberté de marché, qui expliquent pourquoi le climato-scepticisme prospère dans les milieux libertariens dont Elon Musk, par ailleurs propriétaire de la plateforme X (anciennement Twitter), est la figure de proue.
À l’autre extrémité du spectre, des pans de la population, qui s’estiment laissés pour compte, se montrent particulièrement accueillantes envers les théories du complot, qui leur procurent un sentiment de supériorité propre à ceux qui “ne s’en laissent pas compter”. Outre le climat, la médecine est, de longue date, l’un de leurs sujets de prédilection, comme cela est apparu au grand jour pendant la pandémie de Covid-19. Une étude de la Fondation Jean Jaurès, datant du printemps 2023, met en évidence une certaine porosité entre complotistes climatosceptiques, anti-vaccins, anti-système, et même anti-woke. Afin de rester en prise avec ce qui fait l’actualité, et de bénéficier d’un effet “caisse de résonnance”, les mouches changent régulièrement de coche.
Face à cette situation, des garde-fous existent, notamment sur le plan juridique et déontologique. Sur le sujet précis du climat, l’association Quota Climat, créée en 2022 en réaction au peu d’espace médiatique dédié au sujet, saisit régulièrement l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), ou le Conseil de déontologie journalistique et de médiation (CDJM). L’affaire a fait moins de bruit que le non-renouvellement de la fréquence TNT à C8, mais l’Arcom a ainsi mis en garde Sud Radio, suite à une émission “Bercoff dans tous ses états”, dédiée à la COP28 et dans laquelle le climatosceptique François Gervais s’exprimait sans contradiction, en décembre 2023.
Quand l’IA se met au service de l’information
Les associations Quota Climat, Data for Good et Science Feedback lancent un outil de détection international de la désinformation climatique diffusée à la télévision et à la radio !
Basé sur l’état de l’art de l’intelligence artificielle, il fournira aux journalistes, organisations de la société civile et régulateurs, des alertes en temps réel et des analyses pour mesurer la prévalence de discours climatiques trompeurs et y répondre avec des informations précises et fondées sur la science. D’abord déployé en France, le projet contribuera au volet français de l’Observatoire des médias sur l’écologie que publie Quota Climat, et sera ensuite élargi en Allemagne, en Pologne et au Brésil.
À l’échelle européenne, la loi sur les services numériques (DSA), entrée en vigueur en 2023, et la loi sur les marchés numériques (DMA), entrée en vigueur en 2024, ont été adoptées pour répondre à la montée en puissance de la désinformation. Elles introduisent plusieurs mécanismes visant à rendre plus responsables les acteurs des grandes plateformes numériques.
Des conseils déontologiques existent dans une centaine de pays, dont certains vieux de plus d’un siècle, comme en Suède. Mais en France, la création du CDJM, en décembre 2019, n’a pas fait l’unanimité parmi les médias et les journalistes français, qui ont pourtant un rôle central à jouer face à cette déferlante de fake news.
Le rôle essentiel des journalistes
« En démocratie, les journalistes jouent un rôle essentiel de remparts contre la désinformation », insiste Eva Morel. C’est à eux que revient notamment la responsabilité de démonter en direct les affirmations fallacieuses proférées sur certains plateaux de radio ou télévision. Mais il devient d’autant plus difficile de se méfier, voire de désamorcer les propos complotistes, que ceux qui les expriment sont toujours plus nombreux : vrais spécialistes, mais aussi scientifiques sur le retour, éditorialistes ou animateurs en quête de sensationnalisme, élus populistes, etc. Une position iconoclaste sur un sujet comme le climat constitue désormais un élément de distinction susceptible de valoir une tribune médiatique. Surtout si cela s’accompagne de la publication d’ouvrages qui, selon un mécanisme similaire à celui des plateformes, seront d’autant mieux référencés – en ligne, mais aussi en vitrine – qu’ils susciteront le débat.
À l’instar des acteurs des énergies fossiles ou du plastique, certains ont intérêt, a minima, à entretenir le flou sur des faits scientifiques, voire à propager de fausses informations. Mais la caisse de résonnance peut aussi être alimentée par des influenceurs sans aucune légitimité sur le sujet, qui profitent des clics générés par une polémique pour faire du business. Ainsi, après deux ans d’absence, le Youtubeur Raptor s’est fendu, en septembre 2024, d’un long post climatosceptique, guidant tout droit vers ses services de coaching et ses compléments alimentaires. Des anonymes sans opinion, ni même intérêt pour le sujet, peuvent être payés pour diffuser, voire commenter les fake news. Quand ils ne sont pas remplacés par des robots simulant des actions humaines coordonnées, comme c’est le cas avec l’astroturfing. Cette pratique, qui consiste à créer de faux mouvements citoyens spontanés au profit d’intérêts privés ou de partis politiques, se développe avec l’intelligence artificielle. Tout ce qui accentue les clivages d’une société fait le miel des complotistes de tout poil, et nourrit ispo facto une défiance croissante envers les “élites” économiques, politiques et… médiatiques.
Pour autant, d’AFP Factuel à CheckNews, chez Libération, en passant par les Décodeurs du Monde, les équipes de fact-checking ne désarment pas. Et questionnent la moindre information « que n’importe qui pourrait prendre pour argent comptant. Nous nous mettons dans la peau de l’internaute moyen », témoigne Adrien Sénécat, membre des Décodeurs. Il n’adopte pas pour autant la posture de chevalier blanc : « Le fact- checking reste un exercice humble. Celui qui l’exerce ne doit pas porter de jugement, mais simplement fournir les éléments qui vont permettre à chacun de refaire le cheminement. » Et d’insister : « Ce n’est qu’un élément parmi d’autres qui contribuent à une information de qualité ».
Afin de rendre l’exercice accessible à tous, l’AFP a mis en ligne une plateforme de formation en libre accès et une Playlist AFP Fact-Check illustrant plusieurs cas de figure. Malheureusement, comme le démontre la loi de Brandolini, ou “principe d’asymétrie du baratin”, la quantité d’énergie nécessaire pour réfuter une fausse information est beaucoup plus importante que celle qui a permis de la créer. D’un point de vue économique, « la production d’informations fiables, vérifiées, recoupées, est nettement plus onéreuse que celle de contenus à l’emporte-pièce rédigés par des personnes qui ne vérifient pas l’information et ne croisent pas les points de vue », rappelle Adrien Sénécat. Il déplore d’ailleurs l’absence de transparence des plateformes quant à leur modèle économique, notamment en ce qui concerne la rétribution des créateurs, qu’ils soient artistes ou journalistes.
[AG3] La grande limite du fact-checking est qu’il atteint essentiellement des lecteurs qui cherchent à vérifier l’information. « On ne fait pas boire un âne qui n’a pas soif », résume Adrien Sénécat, qui compare l’exercice à celui consistant à apposer des affichettes au bas des immeubles. « Il y aura toujours des occupants qui ne les liront pas, et ne seront pas au courant de la prochaine coupure d’eau. » Pour Célia Gautier, « débunker les fausses informations est intrinsèque à l’éthique journalistique, mais en général cela arrive trop tard ». Cela peut même s’avérer contre-productif, certains voyant dans les efforts déployés pour la démonter, la meilleure preuve de sa véracité, en vertu d’un biais de confirmation bien connu.
Sans compter que le fact-checking est largement absent des réseaux sociaux. Après X, qui a supprimé la modération dès son rachat par Elon Musk, Meta (maison-mère de Facebook, Instagram et WhatsApp) a décidé, en janvier dernier, de mettre un terme à son partenariat avec 80 équipes de fact-checking dans le monde, en commençant par les équipes américaines.
« Il faudrait évidemment que les fake news soient moins visibles, mais il faut surtout explorer des pistes pour que l’information fiable le soit davantage », affirme Yann Guégan, vice-président du CDJM. En Belgique, par exemple, le conseil de déontologie du journalisme procède à de campagnes de communication grand public et ses avis sont mis en avant sur les pages d’accueil des médias.
Reconquérir les citoyens par la confiance… et des formats innovants
Favoriser la visibilité des médias dignes de confiance est l’objectif de la Journalism Trust Initiative (JTI), qui a vu le jour en 2018 au sein de Reporters sans frontières et créé une norme de type ISO. A date, 100 médias ont obtenu leur certification JTI (d’un cabinet d’audit indépendant). « Nous rassemblons 130 organisations (médias, agences de presse, syndicats, plateformes) autour de valeurs communes de professionnalisme, de transparence et d’éthique », détaille son responsable, Benjamin Sabbah. Commettre le moins d’erreurs possibles, et quand cela arrive, les rectifier au plus vite, puis le faire savoir, être transparents à propos de son actionnariat et de ses sources de revenus… une liste de bonnes pratiques constituant une obligation de moyens et reposant sur pas moins de 130 critères a été établie.
La certification JTI se déroule en plusieurs étapes, dont une première phase gratuite d’autoévaluation. C’est seulement dans un deuxième temps que le média peut choisir de se faire auditer, moyennant un coût de 2 à 4000 euros, selon la taille de la rédaction. Une somme qui n’est pas anodine pour certains médias mais qui résulte de tarifs très négociés. « Nous n’avons pas encore obtenu gain de cause pour que les plateformes favorisent les informations produites par des média certifiés », reconnaît Benjamin Sabbah. Ni pour que Google utilise JTI pour son moteur de recherche, à l’inverse deMicrosoft qui l’a intégré au sien (Bing). Elle sert en revanche aux due diligence des fondations qui financent des médias dans certains pays d’Asie ou d’Amérique Latine, ou encore dans les Balkans.
C’est, pour beaucoup de médias, l’occasion d’identifier certaines lacunes, telles que l’absence de charte éditoriale, ou encore de clarifier les relations entre direction et rédaction, affirme Benjamin Sabbah. Si les plateformes ne prennent pas leurs responsabilités en matière de fact-checking, certains acteurs associatifs ou privés s’emparent du sujet. A l’image de l’ONG LaRéponse.tech qui a créé l’application Ask Vera grâce à l’intelligence artificielle, laquelle est d’autant plus susceptible d’être utilisée par les jeunes qu’elle emploie les codes d’aujourd’hui.
Mais à l’heure de la fatigue et, même, de l’exode informationnels révélés par l’étude de l’ObSoCo, quand 53% des personnes interrogées avouent avoir du mal à distinguer une vraie information d’une fausse et que 73% des sondés estiment que la démocratie fonctionne mal, il est plus qu’urgent de rétablir un lien de confiance entre citoyens et médias.
A ce titre, Yann Guégan, regrette que la médiation proposée par le CDJM soit souvent refusée. « Dans les pays où elle est plus développée, on observe des scores de confiance plus élevés », témoigne-t-il. Mais en France, certains médias et journalistes y voient une menace pour la liberté d’expression. « Pour nous, au contraire, la déontologie est une affaire collective », insiste Yann Guégan. Même s’il estime que cela ne va pas assez vite, il juge néanmoins que l’action du CDJM a un impact sur le monde médiatique et journalistique. Il s’interroge toutefois sur sa portée au-delà…
L’éducation aux médias est primordiale. L’association Entre les lignes, par exemple, en est convaincue, elle qui intervient dans les établissements scolaires, auprès de jeunes en réinsertion et même, parfois, auprès d’adultes. « Malheureusement, 30 000 journalistes en France, ça ne suffit pas pour répondre à toutes les sollicitations », regrette Yann Guégan.
Aussi, pour Célia Gautier, « Sur un sujet donné – par exemple le climat – le plus efficace est d’amener la population à un niveau de culture générale suffisamment élevé pour la prémunir contre la désinformation ». Une espèce de vaccin, inoculé de façon collective. « C’est ce que l’on commence à voir avec des formats récurrents, tels les JT météo/climat, qui engagent les lecteurs, auditeurs ou spectateurs », se réjouit-elle. Preuve en est, la proportion de Français qui s’estime bien informée sur le climat a augmenté de 18 points et, selon le Reuters Institute for the Study of Journalism, la France est le pays le mieux informé sur le sujet. Et le moins bien… les Etats-Unis.
Au-delà de l’exigence de fiabilité sur le fond, et de la confiance, indispensable, il y aurait aussi une réflexion à mener pour (re)donner davantage envie aux lecteurs et aux internautes de lire les médias. « Nous, journalistes, devons aussi balayer devant notre porte, abonde Yann Guégan. Mais le sujet est assez peu abordé sous cet angle. » « Il faut mériter la confiance, renchérit Benjamin Sabbah. Notamment en fournissant au lecteur des informations facilement accessibles ».
Selon l’étude de l’ObSoCo, 57% des personnes interrogées trouvent le langage journalistique complexe. « Les nouveaux formats ne sont pas assez explorés », regrette Yann Géguan, qui cite TikTok, où les médias sont peu présents, et encore moins créatifs. A l’inverse, des créateurs de contenus “natifs”, très percutants , se dirigent, eux, de plus en plus vers l’enquête et l’information. « Nous commençons donc à nous rapprocher d’eux afin de les éduquer aux exigences déontologiques. »
Pour Adrien Sénécat, « Quelque chose s’est cassé dans nos pratiques collectives de consommation de l’information, qu’il est possible d’assimiler à de la malbouffe ». Notre défi collectif est de nous redonner goût à la bonne cuisine, voire à la slow food.
______________________________________________________
Enquête extraite de la revue trimestrielle The Good numéro 11 à consulter ici.
Illustration de Doriane Tchekhovitch