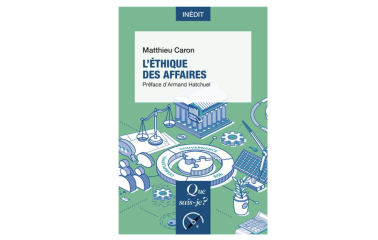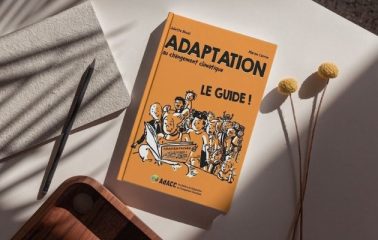The Good : Si l’objectif santé est facilement compréhensible, on peut s’interroger sur les solutions que vous avez adoptées pour résoudre la double problématique approvisionnement et coût ?
Gilles Pérole : Nous voulons une alimentation qui respecte l’environnement et la santé des habitants. Pour ce faire, les produits doivent être sains et c’est le label Agriculture biologique qui a le cahier des charges qui respecte le mieux la santé et l’environnement. Il était également impératif de revoir l’équilibre nutritionnel de nos menus et c’est ce que nous avons fait à partir du plan national nutrition santé. Nous avons augmenté les fruits, les légumes, les céréales et abaissé la part de viande.
En 2007, le Grenelle de l’environnement prévoyait 20% de bio à l’horizon 2012 mais nous nous sommes dit « pourquoi seulement 20%, alors que l’alimentation bio est la meilleure pour l’alimentation humaine et l’environnement ? » Nous avons alors décidé de relever le défi 100% bio. Dès 2008, nous étions à 25% de bio, et sur les trois années suivantes, nous avons fait 25% en plus.
Au premier janvier 2012, nous sommes arrivés à 100%, assez facilement. Plus facilement qu’on ne l’avait imaginé, d’ailleurs !
Sur l’approvisionnement, nous n’avons eu aucun problème ! Même en 2008, car nous avions un grossiste en 100% bio dans la ville voisine. Mais nous ne sommes pas très nombreux non plus. A l’époque, nous avions 10 000 habitants et faisions 1200 repas jour. Le plus gros défi était de maîtriser les coûts, qui ont vite dérapé. L’alimentation bio est effectivement plus chère, entre 20 et 40% de plus, selon les produits.
The Good : Vous avez donc augmenté les budget alimentation ?
Gilles Pérole : Non. Nous avons diminué les coûts pour financer le 100% bio.
Nous avons d’abord travaillé à diminuer le gaspillage alimentaire. Nous avons pesé les restes : nous étions à 147 grammes par personnes et par repas en 2010. La moyenne nationale était alors à 150 grammes. En un an, nous sommes passés à 60 grammes et actuellement, nous sommes à 30/40 grammes, depuis 2012. La moyenne nationale actuelle est à 100 grammes.
Nous n’utilisons pas les grammages recommandés par l’Etat. Ces grammages par type d’aliments, par tranches d’âge, sont surdimensionnés. Nous nous en sommes affranchis en pesant les restes et nous nous sommes créé nos propres référentiels pour faire les achats. Je vous donne un exemple : si on achète 100 kg de carottes pour faire des carottes râpées, qu’il en reste 10kg dans le plat et que, quand en fin de service, on pèse les restes, et qu’on en a 10 kg, alors la fois d’après, on achète que 80 kg de carottes.
Depuis 2010, on pèse tous les jours nos restes alimentaires par catégories et on ajuste en permanence les quantités cuisinées en fonction de la réalité des enfants. Et, pour aller au plus près des quantités, car nous savons que tous les enfants ne mangent pas les mêmes, nous proposons des portions individualisées. Ils choisissent entre grosse ou petite portion. Et ils peuvent se resservir après, bien sûr, si la petite portion ne suffit pas. Nous ne les limitons pas.
Cette baisse du gaspillage nous fait économiser un gros volume d’achat d’alimentaire. En fait, nous jetions un tiers de ce que nous achetions ! En diminuant de 80% le gaspillage alimentaire et en réduisant nos achats, nous avons économisé 20% du budget alimentation.
The Good : Vous avez aussi diminué la consommation de protéines animales … Mais les enfants sont en pleine croissance. Comment répondez-vous à leurs besoins nutritionnels ?
Gilles Pérole : Effectivement, nous utilisons un deuxième levier très puissant sur la maîtrise des coûts, – ce qui nous a notamment permis d’absorber les 20% d’inflation alimentaire qu’il y a eu en 2022-2023 -, c’est la végétalisation des assiettes. Un point qui fait d’ailleurs partie des recommandations du plan national de prévention santé pour limiter l’impact carbone de l’alimentation, et qui permet de faire des économies.
Aujourd’hui, nous sommes à 50% de repas végétalisés. L’équilibre alimentaire se fait sur 20 repas, selon un arrêté du ministère. Sur 20 repas, 10 sont végétariens à base de protéines végétales (et cuisinés maison, car les substituts industriels sont démesurément chers !) ou d’œufs et 10 repas avec protéines animales. Les céréales et les légumineuses apportent des protéines végétales et cela revient deux fois moins cher à produire que des repas avec de la viande ou du poisson. Avec 50% de plats végétariens, nous avons fait 25% d’économie.
En tout, nous avons réalisé 45% d’économie sur le budget alimentation ; ce qui permet de financer le 100% bio et même, de payer le juste prix de l’alimentation aux agriculteurs pour qu’ils puisent vivre de leur travail. C’est aussi un enjeu.
Nous avons un coût de revient inférieur à celui de la moyenne nationale. Le coût alimentation est à 2.18 euros par enfant et par repas, alors que la moyenne nationale est à 2.21 euros avec 6% de bio.
The Good : Pour maîtriser ce coût de revient, vous avez également fait un choix singulier… vous avez créé une régie municipale agricole ?
La régie municipale a surtout été créée pour répondre à un problème de lieu de production, car nous achetions, au grossiste, des légumes qui faisaient le tour du monde…. Ce qui ne nous satisfaisait pas du tout. Nous voulons des légumes très frais et cueillis mûrs car ils sont meilleurs sur le plan nutritionnel et gustatif.
Nous avons pourtant tout fait pour travailler avec des acteurs locaux. Nous avons lancé des appels d’offres, en 2008, pour s’approvisionner en direct. Mais dans les Alpes-Maritimes, il y a très peu d’agriculture et nous n’avons eu aucune réponse. La suite est partie d’une boutade : « Nous n’avons qu’à le faire nous-même ! » Nous avons l’habitude de travailler en régie municipale. A Mouans-Sartoux, tous les services publics sont en gestion municipale, nous avons une régie de transport scolaire, une régie des eaux, des pompes-funèbres, etc. Alors, pourquoi pas une régie agricole ? Nous avons travaillé sur le projet et nous nous sommes lancés en mars 2011. Nous y avons affecté un terrain municipal de 4 hectares en 2011. Et début 2016, nous y avons ajouté 2 hectares en plus d’une propriété voisine que nous avons rachetée.
The Good : Et sur cette ferme maraîchère travaillent… des agriculteurs communaux ?
Gilles Pérole : En 2011, nous avons commencé avec un agriculteur salarié et aujourd’hui, ils sont trois agriculteurs communaux. Ils seront quatre en juillet. Nous allons augmenter la production pour approvisionner les crèches à 100%, contre 50% aujourd’hui, ainsi que l’épicerie sociale : nous créons un nouvel emploi avec le CCAS de la commune.
Sur le budget investissement, nous avons acquis tout le matériel : tracteur, serres, etc. Comme une ferme maraîchère classique mais ce qui change c’est que c’est un modèle public et que nos agriculteurs sont bien payés, ils sont au-dessus de la moyenne des revenus des agriculteurs français et ils ne font que leur métier. Les agriculteurs, habituellement, font aussi le commercial, le livreur, le comptable, secrétaire pour la paperasse, etc. A Mouans-Sartoux, ils se recentrent sur leur cœur de métier.
The Good : Vous avez également investi dans la surgélation. Pourquoi créer une unité de surgélation ?
Gilles Pérole : La ferme municipale approvisionne les cantines et centres de loisirs pendant les vacances mais l’été, pendant deux mois, il n’y a pas d’école. On passe, en juillet, à 450 repas et 250 en août alors que c’est sur l’été que la production est la plus importante. Alors, soit il fallait abaisser la production, soit surgeler la production…. Nous avons créé une unité de surgélation. Nous faisons des réserves en été pour l’hiver.
The Good : La ferme ne produit que des légumes. Avez-vous l’intention d’augmenter la production, voire d’étendre l’action de la régie à d’autres produits alimentaires ?
Gilles Pérole : Nous avons atteint notre vitesse de croisière et nous ne voulons pas faire de l’agriculture intensive. Ce n’est pas nécessaire. En ne cultivant que 4 hectares sur les 6 dont nous disposons, nous produisons déjà de quoi subvenir à 90% de nos besoins en termes de légumes. Les 10% qui restent ce n’est pas tellement un problème de surface, mais un problème de saisonnalité : en mars et avril, il n’y a pas grand-chose.
En parallèle, nous aidons les agriculteurs à s’installer sur la commune pour fournir des produits à la Ville et aussi aux habitants. Toutes les installations sont en bio, nous ne soutenons que ce type de projet. Nous versons des aides en installation bio. Et nous poussons à la conversion des agriculteurs de la commune. Certains de nos agriculteurs sont d’ailleurs passés en bio.
Ce programme a aussi généré un programme de reconquête de terres agricoles. Après avoir créé la régie agricole en 2011, nous avons revu le PLU en 2012 pour augmenter la capacité agricole de la commune. Nous sommes passés de 40 à 112 hectares de terres classées agricoles. Il s’agit de terrains vierges qui étaient classés soient constructibles soit à urbanisation future. La difficulté est ensuite de convaincre les propriétaires privés de terrains non constructibles (mais qui espèrent toujours qu’ils le seront un jour….), de louer leurs terres aux porteurs de projets. Avec la requalification, certains ont perdu une capacité à construire.
The Good : Comment cette perte de terrains constructibles a-t-elle été vécu ?
Gilles Pérole : Au début, pas très positivement. Quand on connaît les prix du mètre carré sur la Côte d’Azur… il y a beaucoup de spéculation foncière. Mais nous avons fait un travail de dentellière pour ne spolier personne. Pour les personnes qui ont perdu des terrains constructibles, nous en avons valorisé d’autres.
Nous avons travaillé de façon pédagogique pour expliquer les enjeux de l’autonomie alimentaire. La Covid et la guerre en Ukraine ont montré l’importance de cette souveraineté alimentaire. Et, finalement, je crois que les propriétaires sont contents car ils ont hérité de ces terres et, quelque part, ils refont vivre ce que faisaient leurs aïeux. C’est un pari que nous avons gagné.
The Good : Quel est le fruit de cette reconquête ?
Gilles Pérole : Nous avons eu sept installations sur les 18 derniers mois et reconquis 20 hectares de terres agricoles sur ces dix dernières années.
The Good : Avez-vous le sentiment que la population partage votre engouement pour le bio ?
Gilles Pérole : Nous avons beaucoup travaillé avec elle. En 2016, nous avons créé une maison de l’éducation à l’alimentation durable qui mène des activités de sensibilisation et d’accompagnements des publics pour changer leur manière de se nourrir. Avec l’Université Côte d’Azur, nous venons d’évaluer 7 actions et constaté qu’en 5 ans, 71 % des habitants ont modifié leurs pratiques alimentaires. En moyenne, ils ont baissé de 30 % leur consommation de produits ultra-transformés, de 23% la consommation de viande et augmenté de 28% leur consommation de bio. Nous avons diminué de 26% l’impact carbone de notre alimentation !