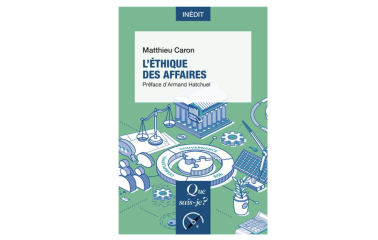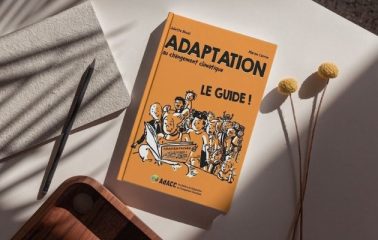Avec 64 chefs d’État présents, la troisième Conférence des Nations unies sur l’océan (Unoc) s’est achevée sur une note contrastée. En toile de fond : une avancée diplomatique majeure avec la ratification du traité sur la haute mer par 50 pays, mais aussi des lacunes notables sur les deux sujets les plus brûlants — les énergies fossiles et le financement de la protection marine.
Un tournant pour la haute mer
C’est la grande nouvelle saluée par les ONG et les diplomates : le traité sur la haute mer, destiné à encadrer et protéger les eaux internationales — soit près de la moitié de la planète bleue — a désormais été ratifié par 50 pays. La première COP dédiée pourrait se tenir dès l’automne 2026, marquant un nouveau cadre de gouvernance pour ces espaces longtemps laissés sans règles.
Pour Johannes Müller d’OceanCare, c’est « un véritable élan mondial » vers une gouvernance plus juste des océans. Mais dix ratifications manquent encore pour que le traité entre officiellement en vigueur.
Fonds marins : tensions autour de l’exploitation
Autre sujet clivant : l’exploitation minière des grands fonds marins, notamment par les États-Unis qui, absents à Nice, ont lancé leur processus d’autorisation pour extraire des métaux précieux au fond des océans. Une initiative que le président Macron a qualifiée de “folie” et que le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a comparée à “un Far West” océanique.
Résultat : la coalition pour un moratoire progresse timidement, de 32 à 37 pays, sur les 169 membres de l’AIFM, l’autorité onusienne compétente. Mais pour l’ambassadeur des océans Olivier Poivre d’Arvor, ce seuil suffirait à bloquer un éventuel code minier.
Aires marines protégées : des annonces, mais pas de révolution
4 pays ont profité du sommet pour créer ou élargir des aires marines protégées, portant leur part à plus de 10 % des océans, contre 8,4 % auparavant. Si certains, comme la Colombie ou les Samoa, ont affiché leur ambition, d’autres comme la France ont déçu, en limitant le chalutage de fond à seulement 4 % des eaux hexagonales.
Le chercheur Enric Sala, de National Geographic, a rappelé l’ampleur de la tâche : pour atteindre 30 % de protection en 2030, il faudrait créer 85 zones protégées par jour. Le compte n’y est pas encore.
Silence radio sur les énergies fossiles
Sujet le plus tabou du sommet : les énergies fossiles, pourtant première cause de réchauffement des océans. Ni le pétrole, ni le gaz offshore, ni même le mot transition ne figurent dans la déclaration finale de Nice.
Une omission que dénoncent de nombreuses ONG, à l’instar de Bruna Campos (CIEL) ou de John Kerry, l’ancien émissaire climat américain : “Il est impossible de protéger les océans sans s’attaquer à leur principal ennemi : les combustibles fossiles.”
Le grand écart financier
Dernier angle mort du sommet : le financement. Les pays du Sud, en première ligne de la crise océanique, n’ont obtenu aucune garantie sur les 100 milliards de dollars annoncés en amont. À l’arrivée, 8,7 milliards d’euros ont été promis — essentiellement via des fondations privées.
Un chiffre très éloigné des besoins réels : selon l’ONU, il faudrait 175 milliards de dollars par an pour protéger efficacement les océans. “Nous n’avons mobilisé que 10 milliards sur les cinq dernières années”, a rappelé Li Junhua, sous-secrétaire général des Nations unies.
Une coopération fragilisée mais vivante
Malgré ces zones d’ombre, le sommet de Nice a ravivé la coopération internationale autour de l’océan. Comme l’a résumé Laurence Tubiana, cheffe de file de l’Accord de Paris : “L’Unoc nous a rappelé que la coopération est encore possible. Mais aucun communiqué n’a jamais refroidi une canicule marine.” La prochaine bataille se jouera en Jamaïque, en juillet, lors de la prochaine réunion de l’AIFM, où l’avenir des abysses sera de nouveau débattu.